Mayet et Menard de Chauglonne
Ce livre a été transcrit sur ordinateur en 2001.
Il a été recopié en respectant la fantaisie de notre ancêtre, ou des habitudes différentes à son époque, face aux majuscules, accents, ou accords (notamment les pluriels et la troisième personne du singulier des verbes finissant par u) [Nous avons cependant corrigé les coquilles et modernisé lĺorthographe, sauf dans les citations de textes déjà publiés. Nous avons aussi développé les abréviations, sauf dans les tableaux, où nous avons au contraire généralisé les croix (« ć ») pour « mort » ou « décédé », systématiquement abrégé les dates, et parfois modifié lĺordre des mentions pour lever des ambiguïtés. Ś NDLR.].
Ce qui apparaît en plus petits caractères [lire « entre crochets, suivi de la mention ôNDLAö ». Ś NDLR.] correspond à ce qui a été rajouté par Albin Mayet entre les lignes ou dans la marge.
Les noms mis en gras ne le sont que pour une meilleure compréhension, les noms soulignés le sont dans le livre [lire « les noms composés en italiques sont soulignés dans le livre ». Ś NDLR.].
Les éléments ajoutés après sa mort, par ses descendants, nĺont pas été recopiés [Ce parti conforme aux normes de lĺédition explique certaines variantes des « notes sur les familles Jaillard et Charmy-Richard » déjà publiées par La Gazette de lĺîle Barbe (n° 23-29) sur la foi dĺune dactylographie partielle. Ś NDLR.], sauf :
- la date de sa mort, bien entendu ;
- le nom de Bourret à la place de Bavosa, pour pouvoir suivre lĺarbre généalogique des Jaillard, modifié.
[Bruno
Guérard et
Marie-Albine
Tillet.]
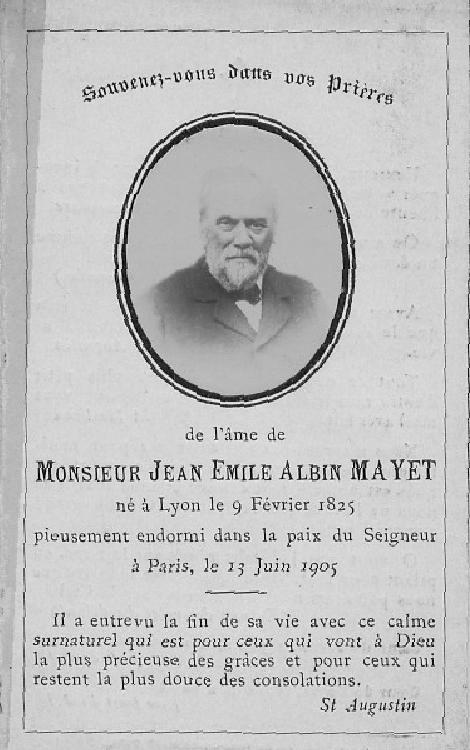
de Jean-Marie
[Émile. Je pensais
supprimer ce nom du xviiie siècle, qui a
compliqué inutilement mon état civil ; mais je
comprends que je dois le maintenir, puisquĺil mĺa été
donné comme filleul de ma vénérée
grand-mère Eymard, née Catherine Émilie
Morizot. Ś NDLA.] Albin Mayet,
né à Lyon, place Saint-Laurent, n° 3, le 9
février 1825 [décédé en son domicile, à
Paris, rue dĺAssas, n° 46, le 13 juin 1905. Ś
NDLE.]
Et majores et posteros
cogitate.
Mes chers Enfants,
Aux siècles qui ont précédé le nôtre, beaucoup de pères de famille se faisaient un devoir de laisser à leurs enfants un livre de raison. Ils appelaient ainsi des mémoires dans lesquels ils leur rendaient raison, cĺest-à-dire compte de la fortune quĺils leur laissaient. Ils y ajoutaient le plus souvent de sages conseils ayant pour but de les faire participer à lĺexpérience quĺils avaient acquise dans leur carrière plus ou moins traversée.
Je veux essayer de remplir ce devoir. Mais, si je puis espérer en réaliser la seconde partie, cĺest-à-dire les conseils, dĺune façon à peine suffisante, je nĺai, hélas ! quant à la première, quĺà mĺefforcer de vous expliquer comment il a pu se faire que trois générations dĺhommes laborieux et honnêtes, jĺose le dire, nĺont pu laisser aucune fortune. Le premier, votre arrière grand-père Mayet a été pleinement excusé par le cataclysme de la grande Révolution, qui a bouleversé son existence. Le second, mon pauvre père, après avoir eu des années de prospérité pendant lesquelles il a travaillé énergiquement et fructueusement, nĺa pas su modifier ses affaires quand les chemins de fer sont venus supprimer le commerce de transit de Lyon et sĺest lancé dans des spéculations hasardeuses, où il a trouvé la ruine.
Quant à moi, pendant de longues et dures années, je me suis efforcé de conjurer cette ruine et ensuite dĺen réparer partiellement les conséquences. Je reviendrai plus loin sur ces vicissitudes pour votre plus grande instruction.
Mais je crois devoir auparavant vous transmettre les souvenirs de famille que jĺai pu recueillir.
La distance dans le monde matériel rapetisse ou estompe les objets. On dirait quĺils sĺévanouissent à mesure quĺon sĺen éloigne. Dans le monde moral, nĺest-ce pas le contraire ? Il semble quĺon voie mieux les choses à mesure quĺon en est plus loin. Lĺhomme âgé, qui nĺa plus devant lui quĺun avenir restreint, essaye de se faire un trésor avec ses souvenirs. Il se demande avec un mélange de tristesse et dĺespérance si la fuite de ces années, qui a lĺair de lĺéloigner de ce quĺil a aimé, ne lĺen rapproche pas au contraire, si la mort ne lui rendra pas ce quĺil a perdu, si ses souvenirs, en se ravivant, ne deviennent pas des présages.
Mon Dieu, quĺils doivent être malheureux, ceux qui refusent de croire à lĺorigine céleste de notre âme et à son immortalité ! Ils sont ainsi privés de la certitude de retrouver ceux quĺils ont aimés.
Je me laisse aller à ces pensées, mes chers Enfants, en me promettant de fixer à votre intention les modestes origines de notre famille.
Jĺai passé ma jeunesse entouré de vieillards ; jĺai toujours pris grand plaisir à leurs entretiens. Il mĺest resté de ces impressions premières un goût pour les choses dĺautrefois que vous avez pu souvent trouver un peu excessif. Aussi ne pensé-je pas que vous puissiez prendre autant dĺintérêt aux notes qui vont suivre que jĺen ai eu à les rassembler.
Cependant, il me semble impossible que vous ne partagiez pas un peu, ne fût-ce que par affection pour moi, ma vénération pour ces grands-parents, pour ces vieux oncles et tantes dont je veux essayer de conserver la mémoire.
Il se produira peut-être aussi telles circonstances où vous pourrez être bien aises de vous rendre compte du degré de parenté que vous avez avec quelque branche collatérale sortie des mêmes souches.
Les tableaux qui vont suivre vous donneront la descendance des familles :
- Mayet et Menard de Chauglonne, dont est issu mon père ;
- Eymard et Morizot, dont est issue ma mère ;
- Jaillard et Charmy, dont est issue votre mère.
Je reviendrai ensuite sur chacune des personnes mentionnées sur ces tableaux dont la mémoire doit nous être chère, ou sur lesquelles jĺai recueilli des particularités dignes dĺintérêt.
Paris, 9 février 1893, jour où jĺentre dans ma 69e année.
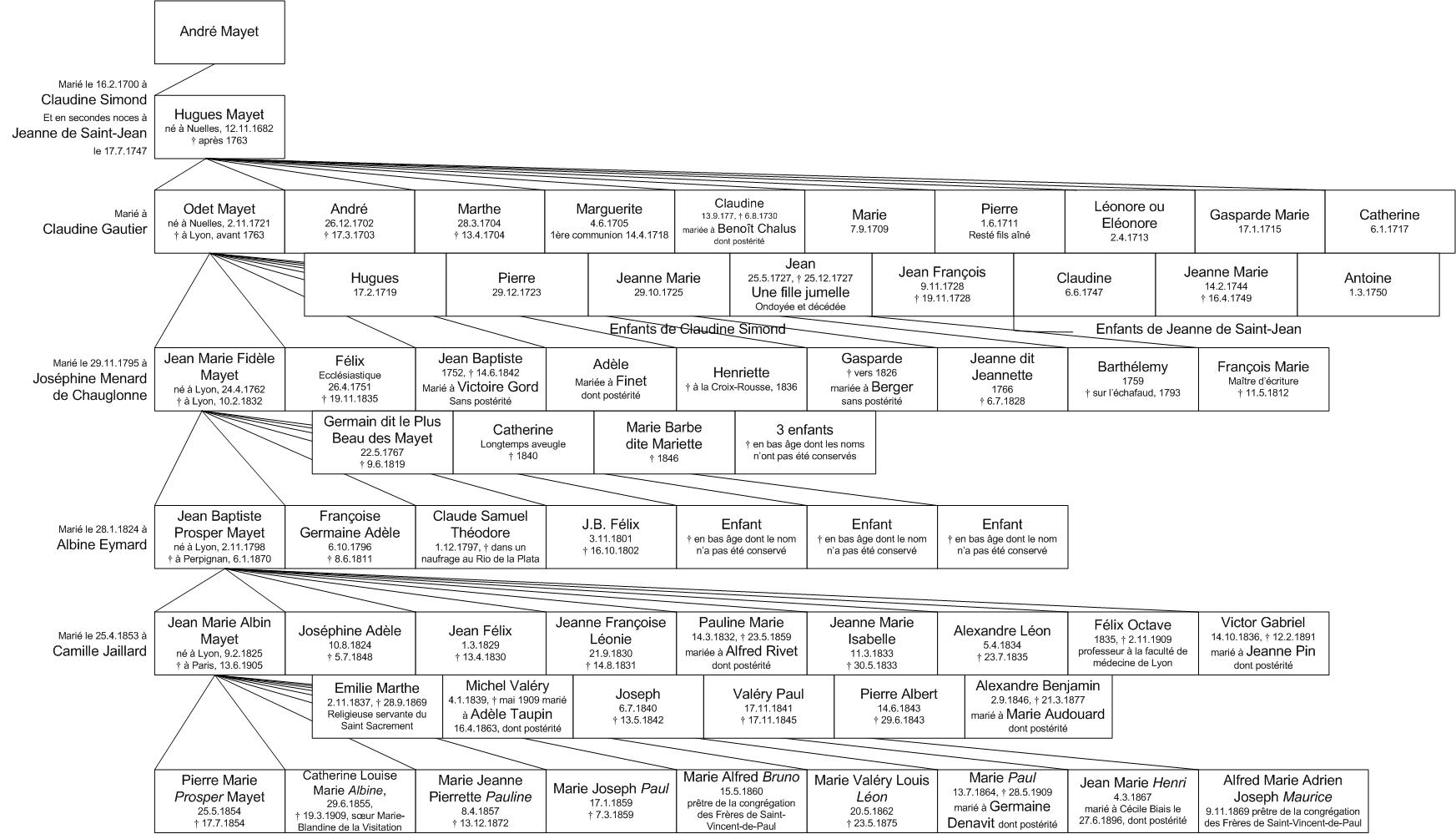
Si lĺon en
croit les étymologistes, le nom de Mayet, porté par
plusieurs familles sorties de la Franche-Comté dĺune part et
du Périgord de lĺautre, aurait voulu dire « lĺhomme
chargé de planter le may », ou
« devant la maison duquel était planté le
may », « lĺarbre » ou
« le mât » autour duquel avait lieu dans
les villages la fête du printemps. Je suis loin de garantir
cette étymologie de notre nom ; mais je la trouve assez
gracieuse pour la
rapporter.
Jĺai toujours entendu dire par mon grand-père,
Jean Marie Fidèle Mayet, et par ses frères, mes
grands-oncles, que leur famille était originaire de Morbier en
Franche-Comté, et dĺailleurs, la plupart des sept vieillards,
hommes et femmes, qui la composaient encore pendant mon enfance
avaient le type de la forte race des Francs-Comtois : taille haute,
grands traits, figure longue, aux pommettes saillantes, teint
éclairé, type qui se retrouvait étonnamment chez
mon frère Gabriel.
Le nom dĺAdèle, donné successivement
à plusieurs femmes de cette famille, est une autre preuve de
cette origine jurassienne. Il nĺy a pas en effet de nom plus
répandu dans les montagnes du Jura que celui-là. Enfin,
nous savons que mon arrière grand-père, Odet Mayet,
était retourné en Franche-Comté pour se
marier ; sa femme, Claudine Gautier, était de La Rixouse,
petit village près de Saint-Claude.
Dĺautre part, cependant, mon grand-père disait
quĺil allait souvent dans sa jeunesse près de LĺArbresle voir
ses grands-parents. Il racontait, à mon grand effroi, que,
faisant le voyage à pied, il avait été suivi un
soir par un loup, dans ce pays alors très boisé, et
quĺune autre fois, par un brouillard très épais, il
sĺétait trouvé entre les jambes dĺun pendu ! En ce
temps-là, on pendait à un arbre les voleurs de grandes
routes sur les lieux témoins de leurs
méfaits.
Cette probabilité du séjour de nos
ancêtres les plus rapprochés dans les montagnes du
Lyonnais est devenue une certitude par la découverte fort
intéressante, pour nous surtout, dĺun journal, ou livre de
raison, écrit par mon trisaïeul Hugues Mayet, né
à Nuelles, près LĺArbresle, en 1682. Cĺest de ce
document, publié dans un ouvrage sur les livres de raison par
M. Vachez, de Lyon, que jĺai extrait la généalogie
des Mayet de Nuelles, qui se rattache à toutes mes autres
notes de famille. [Jĺai pu fort
heureusement rentrer en possession du texte original si
précieux pour nous. Ś NDLA.]
Quand et comment les Mayet de Morbier ont-ils
envoyé un de leurs enfants dans le Lyonnais ? Cĺest ce que
nous ne saurons jamais probablement. Mais le fait nĺa rien de
surprenant ; car de tout temps, les familles franc-comtoises,
très nombreuses et composées souvent de voituriers
rouliers faisant dans toute la France les transports de marchandises
sur leurs légères charrettes, ont envoyé des
essaims un peu partout.
Jĺai retrouvé à Bourg-Saint-Maurice en
Savoie dĺautres Mayet, qui se disaient aussi originaires de Morbier
et dont les fils, revenus à Lyon, lĺhabitent encore.
MM. Mayet frères, actuellement fabricants
dĺétoffes de soie rue du Griffon, sont de cette
branche.
Je reviens à nos ancêtres de
Franche-Comté.
En 1865, ayant été pour mes affaires dans
ce pays, dont jĺai toujours apprécié les bonnes mťurs,
jĺai voulu tâcher de préciser les indications vagues que
mĺavaient données nos traditions de famille. À cet
effet, je me fis remettre par une maison de banque de Lyon une lettre
dĺintroduction auprès de la maison Mayet frères
à Morez, qui mĺétait connue comme faisant le commerce
des bois et la banque. Autant dans les familles comtoises on est
froidement accueilli si on nĺest pas recommandé, autant on y
est de suite à lĺaise si lĺon y est introduit comme ami,
à plus forte raison comme parent. Cette maison Mayet avait
été composée de trois frères, vivant dans
la plus parfaite union, sans partager les biens paternels.
Lĺaîné était mort depuis quelque temps. Le
second, beau vieillard dĺun grand âge, me fit gracieux accueil
quand on lui dit mon nom, quoiquĺil fût à peu
près dans lĺenfance. Sa femme, grande et forte Comtoise, aux
traits masculins, continuait les affaires, aidée dĺun gendre.
Il me fallut accepter un repas chez ces excellentes gens. Ils me
dirent que, si je voulais avoir les souvenirs de la famille, je
ferais bien dĺaller à Morbier voir le troisième
frère Mayet, le plus jeune (75 ans environ), qui gérait
les biens ruraux, restés en commun. Je nĺy manquai pas et,
quand je vis ce brave homme, je fus bien convaincu que je retrouvais
un parent, tant sa bonne figure ressemblait à celle de mon
grand-père et de mes grands-oncles. Je lui demandai
naturellement sĺil avait conservé souvenir dĺune branche de sa
famille transplantée à Lyon. Il ne sut me dire quĺune
chose : cĺest que ses parents lui avaient souvent raconté
quĺils avaient eu à Lyon un cousin ecclésiastique qui
avait été député du clergé aux
États généraux. Ce souvenir me suffisait.
Jĺétais bien en présence de vrais
parents.
Mais quand et comment notre branche sĺétait-elle
trouvée transplantée dans les montagnes du Lyonnais ?
Cĺest ce quĺil nĺa pas su me dire et ce que nous ne saurons
probablement jamais. Je nĺai pas pu combler cette
lacune.
Je pris plaisir au récit un peu légendaire
quĺil me fit des origines de sa famille ; je le rapporte
ici.
Un peu après la révocation de
lĺédit de Nantes (1685) vivait à La Combe de Morbier,
derrière le Mont-Noir, trois frères Mayet, qui
étaient fabricants de tournebroches. Lĺun dĺeux dit aux autres
quĺil regrettait de ne voir des horloges que chez les riches et quĺil
avait en tête dĺen fabriquer de simples et économiques
pour les pauvres, en y employant surtout du bois. Il en fit une en
effet ; mais, ses frères lui persuadant quĺelle ne pourrait
pas marcher, il fit le dessin des pièces qui la composaient et
résolut dĺaller le soumettre à un cousin horloger,
réfugié à Genève, vu quĺil était
huguenot. On sait en effet que la révocation de lĺédit
de Nantes eut pour conséquence de chasser de France un certain
nombre dĺouvriers en horlogerie, qui portèrent leur industrie
à lĺétranger. Notre homme partit donc avec ses dessins,
à pied bien entendu, en promettant à ses frères
dĺêtre de retour au jour et à lĺheure quĺil indiquait.
Les Comtois sont bons marcheurs et de plus gens très
ponctuels. Ses frères, connaissant son exactitude,
lĺattendaient sur le seuil de la maison au jour et au moment
indiqués. Dĺaussi loin quĺil les vit, il leur cria en
patois : Brinli lo !,
cĺest-à-dire :
« Mettez-la en branle ! » Les deux
frères obéissent, font marcher le balancier et, quand
le troisième les rejoint, la première horloge de bois
réjouissait de son tic-tac ce modeste et honnête
intérieur. Le vťu de ces braves gens était
rempli ; à partir de ce moment, ils se firent fabricants
dĺhorloges de bois et Dieu sait combien de milliers de ces utiles et
modestes instruments ont réglé depuis dans
dĺinnombrables familles pauvres lĺheure du lever, des repas et de la
prière.
Les frères Mayet firent ainsi une petite fortune
et la maison où ils habitaient, située à La
Combe, hameau de Morbier, derrière le Mont-Noir, appartenait
encore à la société Mayet frères de Morez
quand je recueillais ces souvenirs. Jĺai su depuis quĺelle avait
été léguée par le dernier survivant
à la fabrique de lĺéglise de
Morbier.
Dĺautres membres de cette famille ont continué la
profession dĺhorloger. Je dois à la complaisance de notre
cousin Francisque Breghot du Lut, archiviste des hospices de Lyon, la
signature dĺun Mayet, quĺil a coupée sur la quittance du prix
dĺune horloge fournie à la Charité de Lyon. On dit
aussi que la grande horloge de lĺéglise Saint-Nizier avait
été faite par un fabriquant de Morbier, probablement
lĺun de nos parents.
Jĺarrive maintenant à nos ancêtres
rapprochés, établis à Nuelles près
LĺArbresle en Lyonnais. À partir de là, je quitte les
récits légendaires et je marche avec certitude,
guidé par le livre de raison de Hugues Mayet, puis par les
traditions précises que jĺai recueillies de mon
grand-père, Jean Marie Fidèle Mayet, et de ses
frères, cĺest-à-dire des fils dĺOdet Mayet, fils
lui-même de Hugues, auteur du livre de raison de
Nuelles.
Mais je nĺai pas cru devoir passer sous silence
lĺorigine franc-comtoise [de notre
famille. Ś NDLA.] parce quĺelle
était bien établie par la
tradition.
Hugues Mayet
était cultivateur et probablement petit
propriétaire, car il ne parle jamais dans son livre de raison
de fermage à payer.
Né le 12 octobre 1682 à Nuelles, il
contracte un premier mariage dès le 16 février 1700,
cĺest-à-dire à peine âgé de 18 ans. De
cette union avec Claudine Simond naquirent seize enfants.
Resté veuf pendant dix-huit ans, il fut
déterminé, paraît-il, à se remarier,
à lĺâge de 64 ans, avec Jeanne de Saint-Jean, par
lĺéloignement ou le décès de tous ses enfants.
Trois autres naquirent de cette union
tardive.
Il vécut jusquĺà un âge
avancé, car le 27 avril 1763, il note encore le
décès du curé de sa paroisse. Mourut-il
bientôt après ? Nous lĺignorons, mais à ce
moment, il avait 81 ans.
En publiant son livre de raison, M. Vachez ajoute
:
« Il ne faut pas demander assurément
à notre vieux paysan beaucoup de développements dans la
rédaction de ses notes journalières. Quoique son
écriture soit bonne, la rédaction semble lui
coûter quelque peine. Et sĺil a bien soin de nous dire quel
jour de la lune est né chacun de ses enfants, ce qui
était, paraît-il, un pronostic de bonheur ou de malheur,
il se borne à mentionner, sous la forme la plus brève
et la plus stoïque le décès de ceux des siens
auxquels il a survécu. Toute son expansion, il la
réserve pour nous rappeler les funestes résultats de
lĺintempérie des saisons, du cruel hiver de 1709, notamment
les fâcheux effets des épizooties qui déciment
son bétail, lĺimpression que lui a causée la nouvelle
dĺune émeute qui vient de troubler la ville de Lyon, la
curiosité que provoque le passage de quelques princes à
LĺArbresle et aussi les ravages causés par le
débordement des rivières qui ruinent les pentes de la
contrée. Ces petits faits, les seuls en effet qui puissent
venir rompre la monotonie de la vie paisible dĺun paysan
attaché à la culture de ses terres et qui ne quittait
guère ses foyers que dans des occasions extraordinaires,
fixaient surtout son attention. Sans doute, les simples notes que
nous a laissées cet honnête cultivateur ne nous font pas
connaître tous les détails de la vie de cette famille
patriarcale, qui formait presque une tribu.
« Mais ce quĺon y trouve suffit pour nous
révéler à la fois lĺhonnêteté
profonde de ces familles rurales dĺautrefois et la résignation
toute chrétienne avec laquelle elles acceptaient la vie de
labeur à laquelle les attachait leur humble
destinée.
« Lĺaisance nĺest pas grande et les dots sont
fort modestes. Les charges imposées par de nombreux enfants
sont lourdes aussi à supporter. On y parvient cependant
à force dĺéconomie et de travail, et parce quĺon sait
se contenter de peu, sans rien sacrifier à un luxe frivole, et
sans témoigner dĺaucun sentiment de basse envie au sort des
classes plus heureuses et plus favorisées de la fortune. Les
filles épouseront un artisan de la ville, ou quelque
honnête cultivateur, comme leur père, et ceux des fils
qui abandonneront la culture des champs iront à Lyon embrasser
une profession manuelle qui assurera leur avenir et leur permettra de
réaliser une fortune que nĺauront point connue leurs
ancêtres.
« Voilà ce qui se dégage du
livre de raison de cet honnête paysan. Aussi lĺimpression quĺon
éprouve de sa lecture est-elle un sentiment dĺestime et de
profonde sympathie pour cette forte race qui a fait notre sol
fécond et en qui résidera toujours au plus haut
degré lĺune des forces vives du pays. » (Extrait de
la brochure de M. Vachez.)
Extrait du livre de raison de Hugues Mayet, son
père : « Le 2 Novembre 1721 sur une heure
avan le
jour & le 9 de la lune, est né Odet Mayet, mon fils, &
de Claudine Simond ma femme. Son parrain a esté Odet
Quétant, fils de Jean Quétant, habitant de Lucenay,
& sa marraine a esté Jaqueline Pain, femme de Pierre
Piquet, habitant de Nuelle. A esté baptisé par messire
Jean Barié, curé du dit lieu, le dit jour à
soleil couchan. »
Et plus loin : « Le premier Mars 1750,
à huit heure du matin & au dernier cartier de la lune, est
née Antoinette, ma fille, & de Jeanne de Saint Jean ma
femme. Son parrain a été André
Ménestrier, mon gendre, tailleur à Lyon, & maraine
Claudine Antoinette Gautier, femme de Odet Mayet mon fils, boulanger
en rue de Flandre à Lyon. »
Je rapporte ces deux textes, qui établissent
dĺune façon précise la
filiation.
Comme je lĺai dit plus haut, Odet Mayet était
retourné prendre en Franche-Comté sa femme Claudine
Antoinette Gautier ; ce qui démontre bien que la souche de
notre famille a été là.
Des Gautier, je sais peu de choses, si ce nĺest quĺun
frère de mon arrière grand-mère est mort fort
âgé, quĺune de ses sťurs, mariée à un
nommé Suell, a laissé des enfants qui se sont
éteints dans la misère, malgré les secours de
leurs cousins Mayet, et quĺune autre sťur, mariée à un
Crozier, a été la tige de la famille de ce nom existant
encore à Lyon.
Cette arrière grand-mère Mayet, née
Gautier, était une femme dĺune grande valeur, ayant nourri
elle-même et élevé admirablement ses nombreux
enfants, qui avaient conservé pour sa mémoire une
grande vénération. Elle paraît être morte
assez jeune et son mari, qui avait pour elle la plus vive affection,
la suivit de près dans la tombe. Jĺai entendu raconter par mon
grand-père que son père, après avoir perdu sa
femme, réveillait quelquefois la nuit ses enfants en leur
disant : « Je viens de revoir votre mère,
levons-nous et prions pour elle », et quĺalors toute cette
famille affligée se mettait en
prière.
Ce digne homme aurait eu de la peine à
élever sa nombreuse famille aussi bien quĺil lĺa fait avec le
seul produit de sa boulangerie ; il y avait joint un petit commerce
de grains et farine. Puis, quittant la rue de Flandre, il
était venu habiter une maison appartenant aux hospices de Lyon
et quĺil gérait comme locataire général. Cette
maison, construite en pierre de taille et de belle apparence,
était située dans le quartier Saint-Paul dans la rue de
la Pérollerie, transformée depuis en quai et
actuellement rasée complètement par les travaux de la
gare Saint-Paul. Sur le fronton de la porte dĺallée se lisait
cette inscription, se rapportant à une ancienne
communauté qui avait bâti la maison : Domus omnis virtutis.
Je lĺai vue moi-même et jĺai souvent pensé
quĺelle pouvait aussi bien sĺappliquer à la patriarcale
famille qui avait habité là. [Notre grand-oncle le chanoine aimait à la
montrer. Cĺétait là quĺil avait été
élevé. Ś NDLA.]
Odet Mayet et sa femme sĺétaient appliqués
évidemment à inculquer à leurs enfants un grand
esprit dĺunion. Jĺen ai eu la preuve par lĺaffection que se portaient
encore, dans leur vieillesse avancée, mon grand-père,
ses frères et ses sťurs ; car jĺai connu sept de ces bons
vieillards.
Leur père, chrétien fervent, ne
sĺétait pas opposé à la vocation
ecclésiastique de son fils aîné Félix,
malgré lĺusage du temps, qui ne laissait guère entrer
dans les ordres que les puînés. Seulement, il avait
lĺhabitude dĺappeler son second fils, Jean-Baptiste :
lĺAîné, ou Mayet
tout court, usage qui sĺest ensuite
conservé dans la famille. Quant à
lĺecclésiastique, on lĺappelait lĺAbbé et plus tard le
Chanoine, et tous ses frères et sťurs lui disaient
vous, en
considération du caractère dont il était
revêtu.
Tout paraît avoir été bien
ordonné dans cette nombreuse et modeste famille. Odet Mayet,
travailleur infatigable, avait tenu à donner une profession
différente à chacun de ses fils, afin quĺils pussent
sĺentraider au besoin, sans être en concurrence entre eux, ou
en contacts trop souvent accompagnés de froissements. À
ce moment venait dĺêtre inventée la machine à
tricoter. Jean-Baptiste fut mis dans cette industrie nouvelle et
lucrative. De Jean Marie Fidèle, mon aïeul, son
père fit un fabricant dĺétoffes de soie.
Barthélemy fut placé chez un épicier droguiste
dont il prit plus tard la suite. François Marie, en raison de
sa belle plume, fut fait maître dĺécriture. Germain
entra chez un commissionnaire en soieries et y fit un chemin
brillant. Quant aux filles, elles apprirent chacune un état
manuel, qui leur fut fort utile quand vinrent les jours mauvais de la
Révolution.
Nĺest-il pas triste de penser que cette belle famille
fut stérilisée, comme tant dĺautres, par lĺaffreuse
tempête de la Révolution ? La plupart de ses membres ne
purent pas se marier. Lĺun dĺeux périt sur lĺéchafaud
après le siège de Lyon. Un seul fit souche, mon
grand-père, qui a conservé le nom et les bonnes
traditions de la famille.
Odet Mayet mourut peu avant la Révolution. Il a
dû être enterré, ainsi que sa femme, dans le
cimetière de lĺéglise Saint-Laurent, dont lĺemplacement
forme maintenant la place de ce nom, à côté de
lĺéglise Saint-Paul. Plus tard, notre famille est revenue
habiter cette même place, mais sans y être amenée
par les souvenirs que je viens de retracer.
Cette place est appelée maintenant place Gerson,
du nom du chancelier Gerson, qui faisait le catéchisme aux
enfants dans lĺéglise Saint-Paul.
Je ne sais rien de son enfance. Mais les quelques
lettres de lui qui ont été conservées
témoignent dĺune instruction bien plus
quĺélémentaire. Il racontait quĺà 16 ans, il
avait été mis en apprentissage chez un ouvrier tisseur
dĺétoffes de soie qui habitait le quartier Saint-Georges,
à côté lĺancienne commanderie des Templiers,
détruite depuis par la création du quai Fulchiron. Ce
maître nĺétait pas tendre. Chaque matin à 5
heures en toute saison, il réveillait le pauvre apprenti, au
son de la cloche du couvent des religieuses Sainte-Claire
situé en face.
Dĺhumeur douce, simple et joviale, Jean-Marie (cĺest
ainsi quĺon lĺappelait dans la famille) se faisait aimer de tout le
monde. Un peu musicien, il faisait danser avec son violon ses
frères, ses sťurs et quelques amis les jours où il
revenait à la modeste maison
paternelle.
À quel moment sĺétablit-il lui-même
fabricant dĺétoffes de soie, avec un associé
nommé Vachon ? Je lĺignore. Mais cette société
paraît avoir prospéré, si bien que son
inventaire, arrêté au 5 mai 1793, bien peu de temps
avant le siège de Lyon, porte : 30 572 livres de
bénéfices antérieurs non répartis, et
23 136 livres profit de lĺannée, mentionnés avec
cette belle formule : « bénéfices quĺil a plu
à Dieu de nous donner ». Au milieu de la tourmente de la Terreur, la
société Vachon & Mayet nĺa sûrement pas pu
réaliser sans pertes son actif, composé de
débiteurs, de marchandises et dĺespèces, dont partie en
assignats.
Je ne sais rien de
lĺexistence de mon grand-père pendant cette terrible
époque.
Mais il paraît quĺà peine le calme revenu,
il se remit au travail ; si bien que dès le 29 novembre 1795,
il épousa Anne, Joséphine, Stéphanie, Robertine
Menard (ci-devant de Chauglonne) (voir son contrat de mariage, lĺacte
de son mariage civil et celui de son mariage religieux
célébré dans une chambre, les églises
nĺétant pas encore rouvertes). Cet acte de mariage religieux
porte cette mention bien remarquable à la date où elle
fut écrite :
« Lesquels conjoints, pour satisfaire à
la religion et à leur conscience, ne regardant les
cérémonies quĺils avaient remplies par-devant leur
municipalité que comme un acte purement civil, qui ne nuit en
rien à la liberté de suivre leur culte comme il a
été expressément déclaré par
lĺarticle 8 du titre 6 de la loi du 20 septembre 1792, nous prient de
leur impartir la bénédiction nuptiale selon le rite de
lĺÉglise catholique, apostolique et romaine,
etc. »
De 1798, date de la naissance de mon père,
à 1808 sĺéchelonne lĺarrivée de sept enfants
suivant le tableau qui
précède.
Je conserve deux lettres de ce bon grand-père,
datées de 1804, adressées à son frère
Germain Mayet à Hambourg à propos dĺun mariage quĺil
lui proposait, lettres qui témoignent de sa bonhomie et aussi
de la bonne affection qui régnait dans cette famille. La chose
nĺeut pas de suite ; Germain aimait mieux son
indépendance de garçon, voyageant pour ses
affaires.
En 1808, la maison de fabrique de Jean-Marie
Fidèle Mayet, après des phases diverses, finit par
succomber. Il se rendit à Paris auprès de son
frère Jean-Baptiste avec lĺespoir de se créer là
une existence. Mais, nĺy réussissant pas, il se résigna
à accepter un poste de commis comptable à la recette de
Castelsarrasin (Tarn-et-Garonne). Je soupçonne quĺà ce
moment, un certain refroidissement, causé par lĺinfortune,
sĺétait produit entre sa femme et la famille Mayet. Comme je
le dirai plus loin, elle prit de son côté un parti
héroïque qui eut les meilleurs
résultats.
De Castelsarrasin, Jean-Marie Fidèle Mayet envoie
à sa femme en mars 1809 une procuration générale
dont elle se servit pour régulariser ses affaires
laissées en désarroi. Le pauvre grand-père avait
un peu jeté le manche après la cognée ; mais
elle non, comme on le verra plus loin.
Cependant, lĺhonnêteté de ce digne homme et
son talent de bon comptable ne tardent pas à lui valoir la
confiance du receveur de Castelsarrasin, qui lui donne, en juillet
1809, sa procuration générale.
Peu après, il écrit une lettre touchante
à sa fille Adèle qui allait faire sa première
communion. Il lui recommande de prier spécialement pour le
succès des efforts faits par sa mère pour lui obtenir
le poste qui permettrait à toute la famille de se
réunir à Lyon.
En septembre 1810, cet heureux résultat est
obtenu, il est nommé économe du lycée de Lyon,
et le receveur de Castelsarrasin lui donne décharge de sa
gestion dans les termes les plus
élogieux.
De 1810 à 1820, il remplit honorablement ses
nouvelles fonctions. Mais ses forces commençaient à
faiblir, il était mal vu comme ancien fonctionnaire de
lĺEmpire. Il fut obligé dĺabandonner sa place. Mon père
voyageait alors pour le compte de la maison Colléta,
épicerie en gros, où il était entré jeune
et avait fait son chemin. Ses lettres à sa mère
montrent combien ce moment fut triste. Elle voit avec raison lĺavenir
en sombre. Il sĺefforce de la rassurer. Il réussit en effet
à fonder lui-même en 1821 une maison qui ne tarda pas
à prospérer sous la raison sociale Mayet & Ronzy.
M. Ronzy avait été son collaborateur chez
M. Colléta.
Pour donner à mon grand-père la
satisfaction dĺun travail utile, on lui confia la caisse de cette
maison, à laquelle il apporta les débris de sa
fortune.
Une lettre de lui dĺaoût 1821, adressée de
Paris à sa femme, explique les difficultés quĺil
éprouve pour des recouvrements de créances et pour
lĺobtention dĺune pension de retraite, à laquelle il nĺarriva
pas.
En février 1824, le mariage de mon père
ramena le bonheur dans la famille. La joie fut grande et les repas de
noce copieux. Jĺen ai la preuve par une note de traiteur que jĺai
retrouvée dans le livre de dépenses de mon
grand-père.
Mais dès 1828, ses facultés furent
compromises par une première attaque dĺapoplexie, suivie
dĺautres qui finirent par lĺentraîner. Les derniers temps de
son existence furent pénibles. Nous ne le voyions plus
à la table de famille, ma grand-mère prenait ses repas
avec lui dans sa chambre. Nous en étions tout
attristés, ma sťur Adèle et moi ; car ce bon
grand-père nous aimait beaucoup. Parfois, il reprenait son
violon et nous jouait de vieux airs pour nous faire danser ; cĺest
là un de mes premiers souvenirs
dĺenfance.
Il mourut le 11 février 1832 dĺune
dernière attaque. Je tiens à revenir sur le
caractère de ce digne homme. Il était avant tout
sincèrement chrétien et parfaitement honnête.
Mais sa bonhommie allait presque jusquĺà la
naïveté. Son livre de dépenses, que jĺai
conservé, en fait foi. On y voit quĺil se plaisait à
faire des cadeaux. En tenant ce livre minutieusement, il ne se
doutait pas quĺil nous laissait la preuve de son caractère
généreux.
Il allait souvent dîner chez ses sťurs, qui
habitaient le quartier de Saint-Just, et qui nĺétaient pas
à lĺaise, mais jamais sans leur porter quelque chose : un
melon, un saucisson, un pâté, le tout noté
exactement sur son livre avec cette mention : « pour aller
dîner à Saint-Just ».
Ce qui montre sa naïveté, cĺest quĺon y voit
quelquefois : « allé seul à la
Crèche » (petit théâtre de
marionnettes).
Jĺy ai trouvé encore lĺachat de deux petits lits,
pour moi et ma sťur. Ils étaient si solides et bien
conditionnés quĺils ont servi à tous mes frères
et sťurs, puis à mes enfants. Attaché à ses
habitudes, il portait encore vers 1830 les culottes courtes, mode
Louis XVI. On le tourmenta beaucoup pour le déterminer
à prendre des pantalons, et réellement, on eut
tort.
Je retrouve bien ses traits, malgré la
différence dĺâge, dans le portrait fait au moment de son
mariage en 1795 et que jĺai fait restaurer. Conservez-le, mes
enfants, en mémoire de cet excellent
homme.
né à Lyon le 26 avril 1751, décédé à Lyon le 19 novembre 1835, ecclésiastique
Comme je lĺai dit, son père ne mit pas obstacle
à sa vocation. Il fit ses études littéraires
comme clerc de lĺantique collégiale de Saint-Paul,
actuellement église paroissiale, très près du
domicile de sa famille. Ces études furent bonnes, il avait de
la mémoire et possédait très bien les auteurs
latins.
Il se rendit ensuite à Paris, où il fit
ses études théologiques dans le séminaire des
Trente-Trois, en suivant les cours de lĺuniversité de Paris,
comme le montre le certificat que nous avons conservé.
Rentré à Lyon, il fut successivement vicaire dans
plusieurs paroisses, puis curé de Rochetaillée. Cĺest
là que la confiance de ses collègues vint le chercher,
bien malgré lui, pour le nommer député du
clergé de Lyon aux États généraux. Une
notice écrite par lui, intitulée Journal des assemblées de lĺordre
ecclésiastique, donne des
détails curieux, et parfois pas très édifiants,
sur les réunions dans lĺéglise des Cordeliers qui
précédèrent cette
élection.
Il siégea naturellement au côté
droit et signa les déclarations et protestations en faveur de
la religion et de la royauté. On trouve son nom
mentionné une dizaine de fois dans le recueil publié en
1834 par le marquis Clermont-Mont-Saint-Jean. Il adhéra
à lĺexposition des principes contre la constitution civile du
clergé par les évêques de France et formula sa
réprobation contre les nouvelles lois par un écrit
intitulé De la constitution de
lĺÉglise catholique, dont jĺai
eu le bonheur de retrouver fortuitement un exemplaire à
lĺétalage dĺun bouquiniste. Cet écrit est très
solide et donne bien la mesure de son caractère sage et
modéré.
Il sĺétait lié dĺamitié avec
lĺabbé Maury, son collègue à lĺassemblée.
Lorsque celui-ci, échappé de la prison de
Péronne, vint rendre compte à la tribune des vexations
injustes dont il avait été victime, il se
révéla pour la première fois comme un grand
orateur.
Lĺabbé Mayet, empressé à le
féliciter, lĺembrassa en lui disant : « Da nos in amplexu mori »,
jeu de mot qui se ressentait bien un
peu du goût de lĺépoque, mais quĺon citait souvent dans
notre famille.
À partir de ce moment, il fut le
secrétaire, ou plutôt le collaborateur de lĺabbé
Maury, lĺaidant à préparer ses discours et souvent
lĺencourageant à monter à la
tribune.
On tenta lĺabbé Mayet par les offres les plus
brillantes pour le déterminer à cesser son opposition
à la constitution civile du clergé ; mais il
résista aussi bien aux faveurs quĺaux menaces. Bientôt
sa vie fut en danger, il se résigna à quitter la France
en suivant lĺabbé Maury à Rome et de là à
la diète de Francfort, au moment de lĺélection de
lĺempereur François II. Lĺabbé Maury ayant
été nommé évêque de Montefiascone,
il se retira auprès de lui. Les détails qui vont suivre
sont extraits du livre de Mgr Ricard, vicaire général
dĺAix, intitulé : Mémoires inédits du cardinal
Maury.
Il est intéressant de revenir un peu en
arrière dĺaprès cet ouvrage et de se reporter à
lĺétat des esprits au commencement de la Révolution
:
« Lĺimagination populaire, dit Mgr Ricard,
sĺexalte quand on apprend que le tiers état à lui tout
seul aura une représentation double, afin de le
préserver du danger de la coalition des deux autres ordres,
parce que, dit lĺédit du roi, la cause du tiers est liée aux
sentiments généreux et aura toujours pour elle
lĺopinion publique. Sa Majesté désire que, des
extrémités de son royaume et des habitations les moins
connues, chacun soit assuré de faire parvenir jusquĺà
elle ses vťux et ses réclamations.
« Le peuple, habitué à regarder
la noblesse et le clergé comme ses maîtres, nĺosait en
croire les crieurs publics et les affiches. Pour le confirmer dans
ses subites espérances, il apprend que lĺélection dans
lĺordre du clergé assure la majorité, non point aux
évêques et aux gros bénéficiers, mais aux
curés, à ces bons et utiles pasteurs, dit encore Louis
XVI dans son édit, qui sĺoccupent de près et
journellement de lĺindigence et de lĺassistance du peuple et
dès lors connaissent plus intimement ses maux et ses
besoins. »
Cet état des esprits explique bien
lĺélection de notre oncle, simple curé de campagne et
sortant dĺune famille absolument plébéienne. Toutefois,
il paraît que, avec son jugement droit et son esprit
réfléchi, il ne sĺétait pas laissé aller
aux espérances et aux illusions générales. Les
événements ne tardèrent pas du reste à
les dissiper même parmi les honnêtes gens, un moment
séduits par les idées révolutionnaires. Sans se
méprendre sur leurs conséquences, notre oncle se
contenta de faire courageusement son devoir et de resserrer de plus
en plus ses rapports dĺaffection avec lĺabbé Maury. Cette
intimité ressort de plusieurs lettres adressées plus
tard de 1823 à 1828 par lĺabbé Mayet au neveu de Maury,
qui avait entrepris dĺécrire la vie de son oncle et qui
demandait des indications à ceux qui lĺavaient
connu.
Lĺoriginal de ces lettres de notre oncle existe dans les
papiers dĺune famille de Provence alliée à Maury. Jĺai
pu en obtenir une copie par lĺintermédiaire de
M. lĺabbé Méric, ami de Mgr Ricard, grand
vicaire dĺAix. Je relate ici quelques extraits de ces lettres
:
« Vous étiez bien jeune,
écrivait lĺabbé Mayet, lorsque votre oncle, pendant sa
carrière législative, remplissait déjà le
monde de ses succès de tribune, de son courage, de son
imperturbable sang-froid à se défendre, puis à
attaquer, à terrasser ses adversaires et à forcer leur
admiration au point de les faire applaudir quelquefois malgré
eux. Je ne connaissais alors lĺabbé Maury que par sa
réputation littéraire et ses Principes dĺéloquence de la chaire.
Je brûlais de trouver une
occasion de lui manifester tous mes sentiments dĺadmiration. Il me la
fournit bientôt : un jour, il me fit don dĺune opinion imprimée
telle quĺil lĺavait improvisée à la tribune. En la
recevant, je lui dis : ôMais, M. lĺAbbé, comment pouvez-vous
retenir presque naturellement ce que vous avez prononcé par
inspiration à la tribune il y a quinze jours et comment
avez-vous la patience et trouvez-vous le temps de lĺécrire
pour le livrer à lĺimpression ? Ś Je nĺécris rien, mais
je cherche des amis qui veuillent bien écrire sous ma
dictée et je nĺen trouve pas toujours. Ś Eh bien, M.
lĺAbbé, vous en avez trouvé un qui vous sera
fidèle si vous voulez lĺemployer, vous me ferez plaisir et je
vous en remercierai.ö Je fus bientôt mis à
lĺépreuve et jĺai eu pendant plus de quinze jours de suite le
plaisir dĺadmirer cette étonnante facilité dĺimproviser
à souhait. »
Le secrétaire obligeant raconte ensuite comment
il couchait souvent chez son collègue afin dĺêtre debout
à la première heure du jour pour se remettre à
lĺouvrage. Le fidèle domestique Gervais le réveillait
de grand matin et il trouvait toujours Maury levé, se
promenant à pas rapides dans son cabinet, prêt à
commencer ses incessantes dictées. Cĺest lui qui
lĺaccompagnait à lĺassemblée le jour du départ
de Paris du roi. La lettre dans laquelle notre oncle décrit
lĺétat de la ville à ce moment est des plus
intéressantes. Elle est aussi la preuve de sa modestie ; car
il faisait là un acte de courage des plus audacieux de se
montrer avec Maury, connu pour le chef ardent des royalistes, et
même de lui frayer passage au milieu de la foule
ameutée. Mais notre digne oncle ne paraît pas rapporter
le fait pour sĺen faire honneur.
À Rome, suivant toujours lĺabbé Maury, il
démêla vite la note discordante dans le concert de
louanges autour de son ami. Sa lettre de 1827 raconte à cet
égard des faits caractéristiques, prouvant bien quĺon
voulait dès lĺabord le perdre dans lĺopinion du pape. Maury
sut du reste se défendre et lĺabbé Mayet ajoute
:
« Le chapitre serait bien long si je savais et
pouvais tout dire ! Comment il a été calomnié
pendant sa nonciature ? On écrivait de Francfort quĺil se
jouait des lois de lĺÉglise, quĺil faisait gras les jours
maigres etc. Mon cťur bondit dĺindignation à ce
souvenir. »
Il nĺest pas sans intérêt de lire dans
lĺouvrage de Mgr Ricard la description de cette petite ville
épiscopale de Montefiascone, où notre oncle passa
plusieurs années paisibles auprès de son ami, quĺil
aidait dans ses efforts pour faire le bien dans son diocèse
:
« En allant de Sienne à Rome par
Viterbe, quand on a dépassé Bollène, on
aperçoit à quelque distance une petite cité
bâtie au sommet dĺune montagne, cĺest Montefiascone. La ville
est peu de chose et nĺa pour elle que la renommée de ses vins.
Mais son site dominateur semble commander à de vastes
contrées. Du haut de ce sommet, le regard embrasse de
magnifiques horizons, dĺun côté le lac et le pays de
Bollène, qui forment les plus beaux tableaux, de lĺautre la
vieille cité de Viterbe, avec son riche territoire, et vers un
autre point, les Apennins.
« Lĺévêché date dĺUrbain
V, qui lĺérigea le 31 août 1369 et y trouva un asile
sûr à son retour dĺAvignon en Italie. Ses
prédécesseurs au
xiiie siècle venaient
là pour fuir les grandes chaleurs de Rome. Le diocèse
était de médiocre étendue, même eu
égard aux usages dĺItalie. Au total 93 églises
cathédrales, collégiales, paroissiales, conventuelles,
pèlerinages et oratoires pour le diocèse de
Montefiascone, et la moitié de ce chiffre environ pour celui
de Corneto, qui lui était uni.
« Tout cela mal administré, avec une
foule dĺabus. On avait dit au nouvel évêque quĺil
trouverait dans sa ville épiscopale un séminaire
florissant. La réalité démentait tristement la
réputation. Les confréries, les
monts-de-piété, etc. réclamaient dĺimportantes
réformes. Maury les entreprit avec une prudence et un
savoir-faire qui les firent accepter des intéressés
plus aisément que le nouveau prélat ne lĺavait
prévu et quĺon ne lĺavait craint à Rome, où
lĺaccession des prêtres émigrés dans la direction
du séminaire avait fait redouter quĺun évêque
français ne soulevât de graves difficultés.
Lĺabbé Mayet fut mêlé à tous ces efforts
de régénération. Ces détails sont
extraits dĺun document important, cĺest la Relatio status ecclesia Montesfalisci juxta
instructionem sacrae congregationis concilie ab Eminentissimo Domino
Joanne Sifredo Maury, presbitero cardinali tituli sanctissimae
trinitatis in monte Pincio ejusdem eccclesiae episcopo exarati
(15 novembre
1796). »
Le clergé de la ville épiscopale voyait
sans aucun ombrage la petite colonie française que
lĺévêque accueillit auprès de lui.
Cĺétaient des prêtres émigrés, confesseurs
de la foi, persécutés pour leur dévouement au
Saint-Siège. Il y avait là plusieurs compatriotes de
Maury, prêtres de Valréas, qui parlaient entre eux le
provençal, que le cardinal aimait tant, le curé de son
abbaye de Lions et son codéputé de Péronne
lĺabbé Caster, lĺabbé Foullon, fils de
lĺinfortunée victime du 22 juillet 1789, lĺabbé
Demandole, de Marseille, qui fut plus tard évêque
dĺAmiens, et dĺautres encore, enfin le bon et cher abbé Mayet,
secrétaire intime de Maury, qui conserva des relations avec la
plupart de ses compagnons dĺexil.
Tous les jours, après le repas pris en commun, on
se promenait en famille, on sĺentretenait dĺétudes, on parlait
de la patrie absente, on sĺégayait en de douces causeries
entremêlées de spirituelles réparties du
cardinal. On en a encore lĺécho dans le journal dĺun des
proscrits, le pieux abbé Picansel, curé dĺAnnonay, qui
garda jusquĺà sa mort un souvenir reconnaissant des
bontés du cardinal.
Cependant, sous la main puissante du premier consul,
lĺordre se rétablissait en France, le concordat avec le
Saint-Siège était
signé.
En 1802, Mgr Maury écrivait au marquis de
Chauvenay, attaché à la personne de Louis
XVIII :
« Il paraît quĺon est fort jaloux en
France de prouver au peuple que la convention arrêtée
avec le Saint-Siège y a parfaitement rétabli le culte
catholique. En conséquence, on presse tous les prêtres
émigrés de retourner dans leur patrie. On les y excite
par beaucoup de caresses et de témoignages de confiance.
Même, on annonce que, si les compliments ne suffisaient pas
pour déterminer leur départ, on leur en donnerait
lĺordre dans un mois. Le ministre de France à Rome les comble
dĺhonnêtetés quand ils vont lui demander des passeports.
Ils se mettent tous en voyage et je ne crois pas quĺil en reste un
seul en Italie à la Pentecôte. On ne néglige
aucun moyen pour les rallier à la Révolution,
puisquĺils ne pourront pas être nommés curés sans
lĺagrément du premier consul. Mon propre secrétaire de
confiance vient de partir pour se rendre à Lyon, sa patrie.
Jĺaurais fait dĺinutiles efforts pour le retenir plus longtemps. Jĺai
cru devoir consentir à son voyage, dans lĺespoir que tout ce
quĺil verrait ou éprouverait en France me le ramènerait
bientôt. »
Il se trompait grandement. Deux aimants puissants
attiraient notre oncle dans son pays : lĺardent désir de
coopérer à la restauration du culte et son affection
pour sa famille. Il fut nommé curé de Trévoux et
y déploya tout le zèle dont il était capable
pour ranimer la foi dans sa paroisse. Cĺest à ce moment quĺil
se lia intimement avec lĺabbé Courbon, grand vicaire, qui aida
si puissamment le cardinal Fesch à relever les ruines de
lĺÉglise de Lyon. Jusquĺà la mort de lĺabbé
Courbon, ils demeurèrent dans la plus grande
intimité.
Une lettre de lui, datée de Trévoux, 10
décembre 1803, à son frère Germain
témoigne aussi de sa constante préoccupation de
lĺétat de sa famille, tristement éprouvée par la
Révolution.
Il était tellement absorbé par son
ministère et tout ce quĺil faisait pour ses frères et
sťurs, comme aîné, quĺil négligeait sa
correspondance.
Mgr Maury lui écrivait le 27 avril 1806
:
« Cĺest la troisième fois, mon cher
abbé, que je vous écris depuis le commencement de
lĺautomne sans avoir reçu de vos nouvelles. Plus je connais
votre amitié et votre exactitude, plus je suis cruellement
inquiet de votre silence. Je pars demain pour me rendre à
Paris. Selon mes calculs, je pourrai arriver à Lyon du 12 au
15 mai. Jĺen partirai le lendemain et, me trouvant pressé, je
me réserverai de voir à fond votre intéressante
ville à mon retour dans le mois de
septembre. »
Il ne devait pas revenir. Lĺappât des grandeurs le
retint à Paris, il fut nommé dĺabord premier
aumônier du prince Jérôme, puis en 1810, il commit
la faute de se laisser nommer administrateur du diocèse de
Paris contre la défense du pape. Il insista à ce moment
pour que lĺabbé Mayet acceptât dĺêtre son grand
vicaire. Mais ce dernier refusa obstinément et ne cacha pas
à son ami son blâme. Le cardinal Maury alla
jusquĺà lui offrir dĺappuyer sa promotion à un
évêché. Lĺabbé Mayet se contenta de le
prier dĺuser de son influence pour lui obtenir le canonicat à
la cathédrale de Lyon. Il voulait, disait-il, passer
là, dans la prière et le recueillement, les quelques
années qui pouvaient terminer sa carrière
agitée. Cette phase de recueillement devait durer bien plus
longtemps quĺil ne lĺavait pensé. À la chute de
lĺEmpire, le cardinal Fesch ayant dû quitter la France, Mgr de
Bernis, nommé administrateur du diocèse de Lyon, voulut
à son tour le prendre pour grand vicaire. Mais son
humilité et son amour de la vie cachée lui firent
refuser cette charge. À ce moment commençait la belle
îuvre de la propagation de la foi. Il fut, paraît-il, le
conseil de Mlle Jaricot, qui en avait conçu le plan. Il
sĺoccupa avec ardeur du développement de cette ťuvre. Ses
sťurs furent du nombre des premiers chefs de dizaines, et pendant
quelque temps, il sĺoccupa de la rédaction des Annales. Jusquĺà la
fin de sa vie, il tint à honneur de dire la messe au
maître autel de la cathédrale le jour de lĺinvention de
la sainte Croix, fête votive de
lĺîuvre.
Cette coopération à la Propagation de la
foi est certainement le principal motif de la
vénération que nous devons à sa
mémoire.
Le 29 janvier 1824, il eut la joie de marier mon
père et ma mère dans lĺéglise Saint-Bruno, dite
des Chartreux. Le discours quĺil prononça et que nous avons
conservé nĺa rien de bien remarquable. On a peine à y
retrouver lĺorateur brillant des États généraux.
Déjà, on peut le dire, ses facultés
sĺétaient un peu
atténuées.
Ce déclin est encore bien plus sensible dans son
testament, daté du 15 octobre 1832.
Ce fut pour toute la famille une peine bien grande de
voir cette intelligence élevée sĺéteindre
graduellement et arriver à tomber dans lĺenfance. Je me
souviens de la tristesse que jĺéprouvais quand mon père
me menait chez lui et que je lĺentendais dire des choses
incohérentes, quoique ses forces physiques fussent presque
intactes. Dans les derniers mois de sa vie, on avait pu le
déterminer à ne plus dire la messe de crainte
dĺaccident, parce quĺil tremblait beaucoup. Mais presque jusquĺau
bout, il sĺest rendu, aidé dĺun bras, au chťur de la
cathédrale, avec la ponctualité quĺil avait toujours
mise à occuper sa stalle aux heures
canoniales.
Jĺai tenu à rapporter ici tous les souvenirs que
jĺai pu recueillir sur ce digne oncle, honneur de notre
famille.
Jĺai conservé son portrait en une plaque
gravée qui a dû servir à lĺimpression de quelque
ouvrage malheureusement perdu. Ce portrait est très
ressemblant et il exprime bien la dignité de cette belle
figure.
Quelques objets lui appartenant me sont restés
:
- un coco sculpté dans lequel il
mettait son tabac ;
- un portefeuille brodé, laissé
par lui en souvenir à ma grand-mère, sa
belle-sťur ;
- et deux chandeliers de bronze doré
légués également par lui à ma
mère.
Il fut de bonne heure mis en apprentissage chez un
fabricant de bas par procédé mécanique. Cette
industrie devint prospère à la fin du
xviiie siècle et
supprima le travail des femmes tricoteuses, dont quelques-unes
jouèrent un rôle si affreux pendant la
Terreur.
Quand jĺétais enfant, ce bon oncle me prenait sur
ses genoux et me faisait dire ce que jĺapprenais ; puis il ajoutait
invariablement : « À quoi ça te servira-t-il,
tout ça ? À ton âge, jĺavais déjà
les fers aux pieds et aux mains, sur mon métier à faire
les bas. » De fait, il paraissait plus illettré que
ses frères et sťurs.
Jean-Baptiste Mayet, appelé par sa famille
lĺAîné (des laïcs) ou simplement Mayet, fit dans cette
industrie une fortune plus modeste que celle de beaucoup de ses
concurrents.
Il se retira de bonne heure des affaires et vécut
assez longtemps célibataire avec ses sťurs, quĺil
affectionnait profondément.
Déjà âgé, il épousa
Victoire Gayet, dĺune famille rurale du Bugey ; il nĺeut pas
dĺenfant et vécut de longues années avec sa femme dans
une maison de la rue Henri-IV, où il était logé
économiquement, car elle était à ce moment
entourée de jardins maraîchers, en arrière de
lĺéglise dĺAinay.
Peu de temps encore avant sa mort, on le voyait tous les
jours se promener longuement à Bellecour avec sa femme, aussi
grande et aussi droite que lui. Le public avait distingué ces
deux beaux vieillards et les connaissait sous les noms de
Philémon et Baucis. Il laissa sa petite fortune à sa
femme, qui mourut huit jours après lui de chagrin,
léguant à son tour cet avoir à des parents de sa
famille, que nous avons perdus de vue.
Je nĺai retrouvé dans les papiers de famille
dĺautre pièce relative à ce bon vieil oncle que son
testament, que je conserve.
a eu pour enfants :
- un fils, Joseph
Finet ;
- une fille mariée à Pierre
Renel.
Joseph Finet a eu deux
fils, lĺun, ouvrier tisseur en soie comme son père, a
élevé péniblement à La Croix-Rousse une
nombreuse famille. Lĺautre a exercé longtemps avec quelque
succès le métier de grillageur rue Ferrandière.
Mon père nĺa jamais perdu de vue cette branche si modeste de
notre famille. Il a souvent secouru lĺouvrier en soie et mĺavait fait
nommer tuteur du grillageur, encore mineur au moment de la mort de
son père.
La fille Finet, mariée
à Pierre Renel, a eu deux fils, tous deux ouvriers miroitiers.
Lĺaîné, Jean Renel, était actif et
intelligent ; mon père lĺaffectionnait en raison de sa
bonne conduite. Marié très jeune à une femme
intelligente comme lui, il végétait, déjà
chargé de famille. Mon père lĺaida à acheter un
fonds de miroitier doreur rue Saint-Dominique, où il faisait
très bien ses affaires, quand il mourut le 8 novembre 1853,
victime de lĺintoxication résultant du dorage par le mercure.
Mon père le fit inhumer dans notre caveau de famille,
où nous nĺavons pas hésité à recevoir les
restes de sa femme sur la demande de leurs enfants. Après sa
mort, son fonds a périclité.
Le second fils Renel, moins intelligent et moins
méritant, est resté ouvrier. Nous lĺavons perdu de
vue.
Mon père sĺest toujours intéressé
à ces parents restés dans une condition
médiocre. Il nous disait que nous ne devions pas les
dédaigner parce quĺils avaient reçu une
éducation moindre que la nôtre. Il appréciait
leur valeur morale, surtout celle de Jean
Renel.
restée fille, dĺun caractère un peu
bizarre, vivait seule à La Croix-Rousse. Je me souviens
seulement que dans ma première enfance, sa sťur Mariette me
menait quelquefois la voir, et quĺelle ne me faisait pas bon accueil.
Les enfants aiment ceux qui les aiment. Elle mourut en
1836.
restée veuve de bonne heure, sans enfants, a
vécu avec ses sťurs Jeannette, Catherine et Mariette,
décédée vers 1826.
restée fille, vivait avec ses sťurs Catherine,
Mariette et Gasparde dans un petit pavillon situé à
Saint-Just au fond dĺun jardin occupé par un pensionnat de
jeunes filles. Quand elle mourut, jĺavais 3 ans ; je nĺai donc aucun
souvenir dĺelle. Mais depuis, jĺai souvent entendu parler dans la
famille de sa douceur et de son enjouement. Ce caractère de
bonté et de bonhomie paraît du reste avoir
été le propre de presque tous les enfants dĺOdet
Mayet.
Je conserve un portefeuille qui avait appartenu à
cette bonne tante Jeannette.
[La nomenclature des victimes de la Terreur à
Lyon éditée à Lausanne et qui existe dans la
bibliothèque de M. de Roncy mentionne Barthélemy
Mayet. Ś NDLA.]
Petit négociant en droguerie rue des Augustins,
fut dénoncé comme suspect, peu après le
siège de Lyon, par un abominable commis qui voulait sĺemparer
de son fonds.
Je nĺai aucun détail sur cette fin tragique, dont
on nĺosait pas parler devant ses sťurs. Il avait laissé dans
la famille une réputation de grande amabilité. Cĺest
aussi lĺexpression de son portrait en grandeur naturelle, qui nous
reste et qui devra perpétuer le souvenir de ce
martyr.
Je ne sais rien de lui que sa profession de maître
dĺécriture et la date de son décès (11 mai
1812), fixée par un reçu, qui a été
conservé, des frais de ses
obsèques.
né le 22 mai 1767, décédé le 9 juin 1819
[suivant extrait de
naissance conservé. Ś NDLA.]
Je nĺai rien entendu dire de son enfance. Mais, comme
ses frères, il avait reçu une instruction
supérieure à celle primaire. On peut en juger par ses
lettres.
Cĺétait un fort bel homme, son portrait miniature
moulé que nous conservons le montre et tous les souvenirs de
la famille le confirment.
Tout jeune, il voyageait pour la maison de son
frère Jean-Marie Fidèle, alors sous la raison de
commerce Mayet & Cie. Parlant lĺallemand,
il allait et venait de Lyon en Allemagne. Un passeport pris par lui
lĺan V de la République (1797) marque la date dĺun de ses
voyages.
Il était à Hambourg quand son frère
fusionna sa maison avec celle de MM. Angénieux et
Hervier. Une lettre collective des associés lui annonce la
constitution de la nouvelle maison et lĺintérêt qui lui
est accordé.
Une lettre, datée de Berlin de février
1800, montre quĺil avait là pour correspondant un nommé
Mayet, probablement un parent éloigné, qui signe :
« directeur des fabriques ». [Voir les notes ci-jointes extraites dĺun journal
lyonnais. Ś NDLA.]
Cette société Angénieux, Hervier
& Mayet ne prospéra pas. Très droit, très
honnête et intelligent, mais dĺhumeur peu facile, Germain Mayet
la quitta en 1804 pour entrer dans celle dĺun sieur Étienne
Perret avec lequel il était intime ; ils se tutoyaient. Cette
société, pour laquelle il continuait à voyager,
est renouvelée en 1808 mais elle ne paraît pas avoir
prospéré, puisque M. Perret consent en 1810
à réduire ses levées à 3 000
livres.
En janvier 1812, toujours voyageant pour la même
maison, il adresse à son frère lĺecclésiastique
une lettre intéressante, décrivant longuement Naples et
ses environs, y compris le Vésuve, dont il fit
lĺascension.
En mai 1814, il adresse à M. Perret, alors
à Brême, une lettre affectueuse lui demandant de
renouveler sa société avec lui, dans lĺespoir, dit-il,
que le retour de la paix leur permettra de recouvrer les pertes
quĺils ont éprouvées. Mais M. Perret, tout en lui
répondant très obligeamment, lui marque sa
décision de se retirer des affaires.
En décembre 1814, il signe un compromis avec son
cousin Étienne Crozier posant les bases dĺune association
prochaine. Cette société est conclue en décembre
1816.
En juin 1818, M. Perret étant mort, Germain
Mayet règle avec sa veuve le dernier bilan de la
liquidation.
Lĺacte de société avec Crozier
frères, préparé par le compromis de
décembre 1814, était loin dĺêtre équitable
en ce qui regarde Germain Mayet, bien quĺil apportât
80 000 francs sur les 100 000 du capital
social.
Cette société fut interrompue par sa mort
et la liquidation, poursuivie par son frère Jean-Marie
Fidèle, fut rendue pénible par le peu de bonne foi quĺy
apportèrent les frères Crozier. De là un
refroidissement complet avec cette branche de la famille, dont la
descendance existe encore à Lyon et qui sĺest trouvée
pendant quelque temps dans une situation
brillante.
Germain Mayet, fort intelligent en affaires, mais
toujours loyal, avait eu quelques années pécuniairement
fructueuses. Mais il avait mené la vie de garçon et de
voyageur.
Grand mangeur et fort buveur, il entama de bonne heure
le tempérament robuste quĺil possédait comme tous ses
frères et sťurs. Atteint à 52 ans dĺhydropisie, il
succomba après quelques mois de maladie, chez ses sťurs :
Marie, dite Mariette, Catherine et Jeannette, qui à ce moment
demeuraient ensemble rue de la
Déserte.
Mon père, tout jeune homme alors, avait pour cet
oncle une affection particulière. Il y avait certainement,
entre ces deux caractères, quelques points de ressemblance,
sauf lĺaustérité de mťurs, dont mon Père ne
sĺest jamais départi. Voyant son oncle perdu, il sĺemploya
à le ramener à la foi de sa jeunesse et il y arriva
facilement.
Germain Mayet était du reste de souche trop
chrétienne pour ne pas tenir à bien mourir ; il
reçut les derniers sacrements de la main de son frère
aîné, en édifiant et consolant tous ses
proches.
Il voulut aussi faire son testament, mais en laissant
toute sa fortune indivise entre ses frères et sťurs, ce qui
montre à quel point la bonne harmonie régnait dans
cette famille.
Elle tint à acquérir pour lui un terrain
concédé à perpétuité au
cimetière de Loyasse, dont nous possédons le titre. Sur
une simple dalle est gravée lĺinscription qui suit,
rédigée par son frère lĺecclésiastique
:
« Ici repose le corps de M. Germain
Mayet, négociant à Lyon, décédé le
9 juin 1819, âgé de 52
ans ;
« Bon, loyal et généreux, il a
couronné par une mort chrétienne une vie honorable,
hélas trop courte pour sa famille désolée et
pour ses nombreux amis.
« Priez pour
lui. »
La gestion de sa petite fortune était
dévolue à son frère Jean-Marie Fidèle,
qui fut ainsi chargé de suivre la liquidation de la maison
Crozier frères & Mayet. Un livre de comptes tenu par lui
relate les sommes encaissées et
réparties.
Mais il fallut en venir aux actes judiciaires pour
surmonter la mauvaise foi des frères Crozier (assignation,
mars 1820).
En novembre 1821 fut signée une convention
transformant le remboursement auquel ils étaient tenus en une
annuité.
En mars 1824, nouveau compromis réduisant cette
annuité de 2 000 francs à
600.
Enfin, en juillet 1824, un dernier traité, de
plus en plus onéreux pour la famille Mayet, est
néanmoins accepté par elle. On comprend bien son
éloignement de parents aussi peu
délicats.
Je tiens bien, mes enfants, à ne pas terminer ces
souvenirs sur la vie de cet oncle sans faire ressortir la
leçon qui en résulte. Sĺil avait suivi modestement les
traces de son frère, notre grand-père, sĺil avait
réglé sa conduite sur les sages traditions de ses
obscurs mais vertueux ancêtres, il aurait certainement fourni
une longue carrière et probablement fondé à son
tour une famille. Cĺest ainsi que, par une loi providentielle, le
défaut de conduite a stérilisé lĺun des rameaux
les plus vigoureux de notre vieille et bonne
souche.
Vénérable personne, devenue aveugle
à la suite dĺune maladie des yeux très douloureuse.
Douce et résignée, elle a passé les
dernières années de sa vie à prier et à
tricoter. Ma sťur Adèle et moi, nous étions pleins
dĺadmiration pour sa douceur angélique et la patience avec
laquelle elle supportait son
infirmité.
était née le jour de la fête de
sainte Barbe et avait reçu son nom au baptême, suivant
un usage ancien. Dans la famille, on ne lĺappelait du reste que
Mariette.
Restée fille, avec ses sťurs Catherine et
Jeannette, elle entoura de soins son frère Germain quand il
revint à Lyon brisé par la maladie. Bonne au fond, mais
dĺhumeur remuante et de caractère inégal, elle est
restée longtemps lĺâme agissante de la famille. Elle
sĺétait à peu près brouillée avec ma
grand-mère Mayet, à laquelle elle était bien
inférieure par lĺesprit et lĺéducation, il faut le
dire.
Elle était pleine de bonté pour ma sťur
Adèle et moi, tenait à nous avoir souvent chez elle
à Saint-Just et savait bien nous divertir. Aussi, nous
lĺaimions beaucoup.
Dans les dernières années de sa vie, ayant
perdu ses sťurs, elle était venue habiter place dĺAinay, pour
se rapprocher de son frère Jean-Baptiste dit
lĺAîné.
Cĺest là quĺelle mourut en 1846,
âgée de 85 ans, ayant ainsi survécu à tous
ses frères et sťurs.
Son testament, que jĺai conservé, témoigne
de son bon cťur : elle y mentionne tous les membres de la
famille qui lui ont survécu et laisse à chacun un
souvenir.
et dĺAnne Joséphine Stéphanie Robertine Menard de Chauglonne,
né à Lyon le 2 novembre 1798, décédé à Perpignan le 6 janvier 1870
Jĺhésite, mes chers enfants, à vous parler
de ce père, que jĺai tant aimé, tout en le redoutant ;
chez lequel jĺai tant admiré certaines qualités
éminentes, et contre lequel il mĺa fallu cependant combattre,
dans ses dernières années, pour ne pas laisser se
consommer entièrement la ruine de notre famille. Mais il
ressort de cette carrière de si hautes leçons que je ne
veux pas que vous en perdiez le profit.
Caractère si fortement trempé quĺil ne
sĺémouvait dĺaucune difficulté et se fiait tellement
à lui-même quĺil ne prenait jamais conseil de personne.
Les brillants succès commerciaux quĺil avait obtenus au
début ont été certainement cause de cette
disposition dĺesprit. Une seule personne avait sur lui de
lĺinfluence, ma chère mère, qui alliait tant de sens
à tant de douceur. À sa mort, il perdit le seul frein
qui pût lĺempêcher de se lancer sur la pente où il
a fait ensuite chute sur chute.
De mťurs irréprochables, dĺune
sobriété austère, il ne connut jamais aucun
plaisir. Il avait fait de bonnes études, uniquement
littéraires, nullement scientifiques, comme elles se faisaient
dans les lycées sous Napoléon Ier ; il en avait
conservé un style châtié et laconique. Enfant, il
fut mis dans un pensionnat dirigé, montée
Saint-Barthélemy à Lyon, par M. Reydelet, qui a
laissé un certain renom comme ayant contribué à
la renaissance des études après la
Révolution.
À lĺâge de 12 ans, il entra interne au
lycée de Lyon avec son frère Théodore. Je dirai
dans quelles conditions en relatant les héroïques efforts
de leur mère pour leur conserver le bienfait de lĺinstruction.
Dirigé par lĺabbé Poupard, vénérable
aumônier du lycée, avec lequel il entretint
correspondance pendant de longues années, il ne cessa jamais
dĺêtre chrétien pratiquant et très ferme
défenseur de sa foi. Il ne fit pas de philosophie pour arriver
plus tôt à aider sa famille et fut placé en 1817
dans la maison dĺépicerie et droguerie en gros dĺun
M. Colléta, où son énergie et sa vive
intelligence lui firent faire un rapide chemin. Jĺai dit plus haut
quels avaient été ses débuts comme
associé avec M. Ronzy, originaire de
Saint-Bonnet-le-Château, qui ne tarda pas à se retirer
dans son pays, se contentant de sa petite
fortune.
De 1820 à 1830, le commerce de transit des
produits du Midi a été en grande
prospérité à Lyon. Avec son activité et
son énergie, mon père en profita pour développer
sa maison, aidé successivement par trois
intéressés de valeur qui étaient entrés
chez lui simples employés : 1° M. Gaufre, fils dĺun
voiturier, qui, distingué par mon père, fit comme
voyageur la prospérité de la maison en fondant sa
clientèle dans le Nord-Est de la France et la Suisse ;
2° M. Bunod, natif dĺOrgelet (Jura), venu à Lyon
avec ses sabots, qui contribua au succès par son esprit
dĺordre minutieux ; 3° plus tard, M. Valette, neveu du
vieux M. Ronzy, qui continua lĺťuvre de M. Gaufre par ses
voyages. Mais déjà dans cette phase heureuse, mon
pauvre père montra cette générosité
absolument démesurée qui plus tard contribua à
compromettre sa fortune. Il fit une part réellement trop large
à ses aides, dont lĺavoir grandit, tandis que le sien ne se
développa que lentement au milieu de dépenses de
famille croissantes et dĺactes de libéralité souvent
excessifs. Quand ensuite il crut bien faire dĺimmobiliser toute sa
fortune en achetant la maison du port Neuville (quai Saint-Vincent,
26) et quĺil la géra dĺune façon si libérale
quĺelle nĺétait guère habitée que par des
parents ou des amis, il arriva que le commerce nĺeut à peu
près plus de fonds de roulement que ceux des
intéressés, qui firent de plus en plus la
loi.
Après 1848 vinrent les chemins de fer, qui
ruinèrent le commerce de transit de Lyon. À ce moment,
au lieu de conserver ses droits sur la succursale que M. Valette
avait fondée à Paris, il le laissa seul en jouir. Au
lieu de créer une maison dans le Midi pour continuer les
affaires sérieuses et effectives, il se lança dans les
spéculations les plus hasardeuses avec une
frénésie peu explicable de la part dĺun homme aussi
grave.
Dĺautre part, épris de sa maison, à
laquelle il attribuait une valeur exagérée, il
entreprit la transformation de ses vastes dépendances et y
engouffra le peu de capitaux liquides qui lui restaient. À
partir de 1853, une série de pertes graves résultant de
ses spéculations malheureuses acheva de miner son commerce. En
vain, pendant plusieurs années, je prolongeai mes efforts (en
qualité dĺemployé intéressé) pour
soutenir le crédit que lui valait son ancienne renommée
par les plus pénibles démarches. Je ne puis penser sans
effroi à la vie que je menais alors, toujours mĺattendant
à ce quĺune échéance nous acculât à
la suspension de payements, toujours luttant au moyen
dĺexpédients, par moments me berçant de la fausse
espérance quĺune heureuse opération nous sortirait de
lĺabîme. Enfin, en juillet 1857, la lutte devint impossible. En
face dĺune échéance que nous ne pûmes pas
franchir, mon pauvre père, ne pouvant supporter son
déshonneur, prit la triste et dangereuse détermination
de partir pour Paris, sans comprendre quĺil sĺexposait par là
aux plus graves conséquences.
Je dressai à la hâte le bilan et je
provoquai une réunion des créanciers, dans laquelle
notre cousin Didier exposa la situation et me proposa pour faire,
sous la surveillance de trois commissaires, une liquidation amiable,
moins onéreuse que celle judicaire. Le traité
établi à cet effet fut signé séance
tenante par le plus grand nombre des créanciers. Mais
pénibles et longs furent ensuite mes efforts pour y amener
plusieurs récalcitrants. Cependant, par ce fait, mon
père avait échappé au déshonneur de la
faillite.
Pour ne pas le laisser seul à Paris, ma sťur
Marthe, puis notre grand-tante Fanny Morizot lĺy
rejoignirent.
Toujours poursuivant ses rêves de
bénéfices spéculatifs, mon père pendant
deux ans prit encore là dĺimprudents engagements, tout en me
compromettant, malgré moi, dans une certaine mesure. Enfin,
réduit à lĺimpuissance, il se résignait à
chercher une situation subordonnée quelconque quand, à
la suite de négociations longues, je lui obtins dĺentrer comme
employé principal, chargé de la correspondance, dans la
maison Noilly, Prat & Cie de Marseille, en
mĺappuyant sur lĺancienne affection que M. Noilly lui avait
conservée. Il laissa à Paris ma sťur Marthe, que les
épreuves avaient mûrie au point de lui donner la
vocation religieuse ; elle était entrée chez les
Servantes du Saint Sacrement.
Il repassa par Lyon incognito et fut
prendre possession de son poste. Autant je lĺavais vu peu auparavant
à Paris abattu, déprimé, autant il nous parut
à ce moment redressé et plein dĺespoir. Il est certain
quĺalors ses facultés nĺétaient nullement
atténuées. Telle une statue antique, gisant sur le sol,
redevient imposante, quoique mutilée, lorsquĺelle est
replacée sur son socle. Notre tante, restée en
arrière quelques jours à Paris, passa seule par Lyon
pour aller le rejoindre et nous découvrit alors sa nouvelle
situation : mon père lĺavait épousée
!ů
Dans notre respect pour la mémoire de notre
mère, nous nĺadmettions pas, mes frères, mes sťurs et
moi, que personne pût prendre sa place. Nous nĺacceptâmes
pas sans peine ce mariage entre deux vieillards unissant leurs
infortunes. Plus tard cependant, nous reconnûmes que la
Providence lĺavait probablement voulu pour ne pas laisser mon
père dans lĺisolement.
Mais la situation assez obscure quĺil avait dans la
maison de M. Noilly ne pouvait suffire à son
activité. Il obtint de lui quĺil lui confiât la
direction des achats de vins et spiritueux en Languedoc et se
transporta à Sète. Là, sa gestion entreprenante
effraya M. Noilly, qui mĺécrivit : « Votre
père me fait peur.
Il me parle dĺappeler son fils
Valéry pour lĺaider. Jĺaime mieux leur faire ouvrir un
crédit chez mon banquier, sous votre caution, pour leur
permettre de fonder une petite maison qui leur permettra dĺutiliser
vos anciennes relations dans le
Nord. »
Jĺeus le tort dĺaccepter ces ouvertures, je donnai ma
caution. Jĺai fait là ma seconde grande faute. Le rachat
à prix élevé de la maison du port Neuville pour
améliorer la liquidation Mayet & Cie avait
été la première. Ces deux imprudences ont
pesé sur tout le reste de ma carrière. Je me persuadais
quĺaprès tant dĺépreuves, mon père était
revenu à des idées plus prudentes. Lui-même
lĺassurait. Je ne consentis cependant à donner cette caution
quĺà la condition quĺun relevé des écritures de
la maison, constituée sous le nom de mon frère
Valéry, me fût envoyé tous les mois. Une
première année donna un résultat très
bon, inespéré. Mais alors on prit un agent de vente
à Paris contre ma défense, on sĺaffranchit de mon
contrôle, et bientôt les mauvais crédits mirent
cette maison à deux doigts de sa perte. Toujours sous ma
caution, M. Noilly consentit à lui faire une avance qui
lui permit de ne pas sombrer immédiatement ; mais à la
condition que mon père en sortît. La famille
entière insistait pour quĺil se rapprochât de Lyon. Lui
au contraire voulut sĺéloigner de plus en plus et il se retira
à Perpignan, où il fut soigné, il faut le dire,
avec le plus grand dévouement par notre tante, jusquĺà
sa mort survenue le 6 janvier 1870. Nous dûmes, dans cette
dernière phase de son existence, subvenir à ses
besoins. Plusieurs fois, à grand-peine, jĺétais
allé le voir aussi loin. Je nĺeus pas cette consolation
à ses derniers moments ; mais il fut entouré par mes
frères Octave, Valéry et
Benjamin.
Voici copie de son testament, dont lĺoriginal est
resté au greffe du tribunal de Perpignan
:
« Je ne sais où je rendrai mon
âme à Dieu. Je tiens essentiellement à conserver
à ma bonne compagne et tante, qui a été mon aide
et mon soutien dans mes chagrins et tribulations, indépendance
et tranquillité, si je quitte ce monde avant elle. Je nĺai que
des créanciers, assez et trop, mes enfants le savent ! Jĺaurai
jusquĺà mon dernier souffle lĺamère affliction de
nĺavoir pu les satisfaire, suivant lĺardent désir qui nĺa
cessé de mĺanimer. Je nĺai donc de dispositions à
prendre que pour quelques meubles, le peu que je pourrai
laisser.
« Quĺà mon décès,
personne ne prétende à la moindre des choses dans notre
appartement. Tout ce quĺil contiendra devra être
considéré comme lĺentière
propriété de Fanny Morizot, qui, dans maintes
occasions, mĺa avancé des sommes résultant de ses
épargnes personnelles.
« Que nul ne mette donc en avant le moindre
droit contre lĺintention formelle que je consigne
ici.
« Je déclare mourir dans la foi
catholique, apostolique et romaine.
« Je supplie mon souverain maître et
juge de recevoir mon âme dans sa miséricorde et selon sa
bonté infinie.
« Je prie la Très Sainte Vierge de
mĺassister à mon dernier moment et dĺêtre pour moi
janua coeli, ce que je lui ai demandé
souvent. »
Signé : « Mayet
père. »
« Perpignan, 20 juin
1864. »
Il va sans dire que nous aurions exécuté
les dernières volontés de notre père en faveur
de notre grand-tante, mais elle-même mourut huit jours
après lui. En raison des droits que pouvaient faire valoir ses
neveux personnels, nous fûmes obligés de régler
cette double succession judicièrement, quoiquĺelle fût
en déficit.
Pour la seconde
fois, je rachetai quelques-uns des
meubles dont jĺavais nanti mon père lors de la liquidation
Mayet & Cie, et auxquels se rattachaient des
souvenirs.
Nous ramenâmes successivement à Lyon les
restes de ces deux pauvres exilés volontaires. Ils reposent
dans notre tombe de famille.
Je tiens bien, mes chers enfants, à ce que vous
ne jugiez pas ce pauvre père dĺaprès la triste fin de
sa carrière.
Cĺétait une haute intelligence et un noble cťur.
Mais, par un contraste étrange, ses grandes qualités
ont été compromises par deux tendances également
funestes : la présomption qui le portait à ne jamais
prendre conseil de personne, puis son inexplicable attrait pour les
entreprises risquées et les opérations
aléatoires.
Jĺai lu quelque part que, sĺil est bon
dĺapprécier les chefs-dĺťuvre littéraires en raison des
beautés quĺils renferment, sans tenir compte des pages
faibles, il semble que nous pouvons bien juger de même les
caractères hors ligne.
Or, celui de mon père en était
un.
Fils dévoué sĺil en fut, il soutenait vers
1820 sa pauvre mère par lĺespoir des jours meilleurs quĺil
allait lui procurer. Sa correspondance de ce temps, heureusement
conservée par elle et que jĺai recueillie, prouve quelle a
été sa précoce valeur. De quels soins nĺa-t-il
pas entouré ensuite cette mère et ce père
auxquels il a assuré une vieillesse heureuse ? Ce
nĺétait pas pour eux seuls quĺil avait des égards, mais
aussi pour ses vieux oncles et tantes, auprès desquels il se
plaisait à passer une partie de ses heures libres du dimanche,
quoique tous, excepté le chanoine, lui fussent bien
inférieurs par lĺintelligence et
lĺéducation.
Sous une autre forme, son grand cťur nĺa cessé de
se manifester toute sa carrière. Que de gens il a aidés
de son crédit ou de sa bourse ! Que de courages abattus il a
relevés par dĺénergiques paroles ! Sa charité
était presque sans bornes, sa libéralité
vis-à-vis de ses proches peut-être
excessive.
Fier et quelquefois sarcastique, bien à tort,
avec les gens de sa classe, il nĺavait au contraire que de bonnes
paroles pour les petites gens. Aussi, avec quelle affection il
était servi par ses domestiques et ses employés !
Travailleur infatigable, ne connaissant aucun plaisir, même
honnête, il donnait lĺexemple à ses ouvriers et exigeait
beaucoup dĺeux. Mais tous le respectaient et lĺaimaient parce quĺil
était juste.
Pourquoi a-t-il fallu que ses grandes qualités
aient été compromises par de véritables lacunes
au point de vue financier ? Il répétait souvent ces
deux adages :
« Nul nĺa rien sans
peine. »
« Laissez dire et faites
bien. »
Certes, il avait raison ; mais il interprétait la
seconde de ces maximes dĺune façon exagérée en
dédaignant lĺopinion dĺautrui et agissant au
hasard.
Jĺai toujours pensé que, militaire, il aurait pu
être un grand capitaine. Il en avait du reste la prestance.
Tandis que, négociant, il a déplorablement compromis
une carrière brillamment et honorablement
commencée.
Mais il a paru au tribunal suprême les mains
pleines de tant dĺactes charitables que Dieu a bien dû le
recevoir dans sa miséricorde infinie.
Fille charmante, vertueuse, intelligente et belle, dont
la mort prématurée fut pour toute la famille une grande
douleur.
Elle avait été emmenée à
Paris par sa mère pendant le séjour quĺelle y fit. Je
conserve un livre classique lui ayant appartenu et plusieurs lettres
dĺelle à son père, qui marquent le développement
graduel de son intelligence et de son affection pour ses
parents.
Un reçu de frais dĺinhumation conservé
marque la date de son décès. Ses restes furent
ultérieurement transportés dans la tombe de son oncle
Germain Mayet. Sa mémoire est restée vivante dans la
famille.
Il fit ses études avec mon père au
lycée de Lyon.
Écolier turbulent, jeune homme indompté,
il fut pour ses parents la cause de beaucoup de chagrin. Finalement,
lĺidée lui prit de partir pour lĺAmérique du Sud avec
lĺespoir dĺy faire fortune. De janvier à mai 1819, son oncle
Germain lui fit quelques avances sĺélevant ensemble à
4 500 francs, représentées par des reçus
que jĺai retrouvés et qui sont restés naturellement
impayés. Avec cette somme, il se constitua une petite
pacotille dĺétoffes, rubans et autres articles de mode. Puis
il partit pour le Brésil avec un camarade non moins
écervelé que lui, Louis Reynard, fils dĺune famille
amie de la nôtre, lequel le quitta bientôt pour se
diriger sur le Venezuela, où il a vécu longtemps comme
planteur.
Théodore Mayet, lui, repartit du Brésil
pour le Rio de la Plata sur un navire qui fit naufrage aux bouches de
ce fleuve. Détail horrible, qui ne fut jamais connu de sa
mère, un autre navire, en visitant dans ces parages un
îlot désert, y trouva les restes des naufragés,
dont il faisait partie, qui sĺy étaient réfugiés
et y moururent de faim et de misère.
nĺa vécu quĺun an.
Son premier nom lui fut donné comme celui de sa
marraine, notre grand-mère Mayet. Le second en mémoire
de cette tante Adèle, sťur de notre père, si
regrettée. Hélas, ce nom nĺa pas pu rester dans la
famille. Ma bien-aimée sťur, comme sa tante, quitta la vie
jeune encore. Jĺai connu dĺautres exemples pareils de noms qui
paraissaient prédestinés. Ne semble-t-il pas que les
aînées rappellent auprès dĺelles, au
séjour du bonheur, leurs jeunes pupilles, encore dans la fleur
de lĺinnocence, pour les préserver du contact de notre triste
monde ?
Mon enfance et ma jeunesse se sont passées avec
cette bonne petite sťur. Nous nous aimions tendrement. Plusieurs de
nos frères et sťurs nĺayant pas vécu, nous avons
été ensuite considérés comme devant aider
nos parents à soigner ceux qui vinrent plus tard. On nous
appelait « les
grands » et lĺon nous avait
donné une certaine autorité sur les plus
petits.
Enfant, ma chère Adèle était vive
et intelligente, mais très peu capable dĺapplication. Notre
sévère grand-mère Mayet, qui habitait avec nous,
ne lui épargnait pas les remontrances et croyait bien faire de
la contraindre. Hélas, cette jeune chevrette aurait eu besoin
quĺon la laissât bondir à son gré jusquĺà
ce que son tempérament fût formé. À partir
de 14 ans, elle subit cette phase fatale à tant de jeunes
filles. Trop tard, vers 18 ans, on sĺen rendit compte. On la fit
monter à cheval, on cessa de la forcer à
lĺétude. De 18 à 21 ans, elle déclina. Au
printemps de 1848, pendant que les événements
suspendaient tout travail, je la menais souvent à la campagne
dans une voiture attelée de son petit cheval, Carabi, quĺelle avait
ramené des eaux du Mont-Dore à la suite dĺune saison
quĺelle y fit avec notre mère. Nous nous asseyions au grand
air, admirant lĺordre et le calme de la nature, tandis que dans les
villes, les hommes mettaient tout en désarroi. Il me semblait
que ces bonnes journées lui faisaient du bien, elle le disait
du moins et formait mille projets dĺavenir, symptôme trop
fréquent de la fin prochaine de ceux qui ne doivent pas tarder
à sĺéteindre.
Le mal reprit sa marche et cette belle âme
retournait auprès de Dieu le 5 juillet de cette triste
année. Pendant ses dernières heures, ne se faisant plus
aucune illusion, ayant reçu avec ferveur les secours de la
religion, elle voulait sĺefforcer de vivre quelques instants de plus
pour revoir notre petit frère Benjamin, envoyé quelque
temps à la campagne. La pauvre enfant, avec une énergie
admirable, se faisait mettre des sinapismes, se persuadant quĺelle
pourrait ainsi se ranimer. Elle nĺy réussit pas, se
résigna et sĺendormit doucement.
Je conserve de cette chère sťur, que jĺai tant
aimée, son portrait sur plaque daguerréotype fait
après son décès, un herbier commencé par
elle avec beaucoup de soin, et quelques lettres qui témoignent
de son instruction un peu incomplète, mais aussi de la
vivacité de son esprit et de la richesse de son
cťur.
[Jĺai remis lĺherbier à mon frère
Valéry. Ś NDLA.]
Enfant, elle était très délicate,
mais elle prit le dessus plus tard et elle aurait certainement pu
fournir une carrière plus longue sans les épreuves qui
ont traversé sa courte vie de mère de famille et sans
lĺinfluence, très mauvaise pour elle, du climat du Nord,
où elle dut vivre quelques années au milieu de
vicissitudes pénibles.
Elle fut mariée un peu imprudemment à
Alfred Perret, qui ne tarda pas à perdre la position modeste
et peu assurée quĺil avait chez ses cousins Perret
frères & Olivier, devenus depuis colossalement riches.
Alfred Perret occupa ensuite dans le Nord le poste de sous-directeur
dans plusieurs sucreries successivement. Ma pauvre sťur, à la
suite dĺune série de maladies, nous revint à Lyon dans
un état désespéré. Notre
grand-mère Eymard, pour tenter de la remettre, lĺavait
installée au salon de sa maison donnant sur le jardin, en
plein midi. Mais ces soins étaient bien trop
tardifs.
Le 23 mai 1859, elle expirait à 27 ans, laissant
quatre enfants : Irénée, Jeanne, Hélène
et Marthe.
Son mari était accouru, quittant son travail.
Avec le plus grand courage, elle sĺefforçait de lui faire
illusion, quoiquĺelle nĺen eût pas elle-même. Le matin de
son dernier jour, elle essayait de lui dire quelques plaisanteries
et, comme il partait en dissimulant ses larmes, elle disait à
notre bonne cousine Adrienne, constamment auprès de son lit :
« Tu vois bien quĺil faut tâcher de lui donner
courage. »
Peu après, elle demandait elle-même
quĺAdrienne lût les prières de la recommandation de
lĺâme et elle allait recevoir la récompense de sa
carrière si courte, mais si pleine de souffrances et de
mérites.
Marie était dĺun caractère paisible et
recueilli. Elle avait fait toutes ses études à la
maison sous la direction de Mme Guyenot, femme distinguée,
très capable de la former au point de vue littéraire.
Ma sťur avait bien profité de ses leçons ; elle
était instruite et écrivait avec facilité. Je
conserve dĺelle de nombreuses lettres qui en témoignent. Mais
cette excellente nature eût été faite pour une
carrière non agitée. La sienne le fut,
hélas ! par suite des premiers insuccès de son
mari. Et, quand sa santé vint à péricliter, elle
souffrait beaucoup de son impuissance à conjurer
lĺadversité par lĺactivité qui lui manquait ; ce
quĺelle reconnaissait elle même.
Peu après sa mort, sa petite Jeanne [(née le 8 septembre 1855,
décédée le 8 juillet 1859). Ś NDLA.],
la plus belle de ses filles, la
suivait, emportée par la
diphtérie.
À quelques années de là, Alfred
Perret, établi fabricant de sucre à Roye (Somme),
céda avec raison aux instances de sa famille et se remaria
avec Mlle Joséphine Quantin, dĺune famille honorable de
Saint-Étienne, qui mit le plus grand dévouement
à élever les trois enfants survivants de ma sťur
quoiquĺelle en eût elle-même de nombreux. [(Alfred Perret, après de cruels revers de
fortune, est mort le 16 décembre 1890.) Ś
NDLA.]
1° Irénée
[né le 13 août 1854. Ś
NDLA.], après avoir, comme
écolier, donné peu de satisfaction à sa famille,
a fait ses études dĺagriculture à lĺécole de
Grignon. Placé comme régisseur successivement dans
plusieurs grands domaines, puis dans lĺadministration des
forêts domaniales de Tunisie, il a pris en dernier lieu une
gestion agricole en Algérie.
[En 1899, Irénée, devenu
propriétaire de lĺancienne ferme de lĺÉtat dite La
Bergerie, à Ben-Chicao, province dĺAlger, a
épousé Mlle Marie Perrey, restée fille
jusquĺà près de 40 ans et ayant acquis une modeste
aisance en donnant des leçons de piano à Paris. Mais
elle ne tarda pas à se lasser de la vie plus que rurale
quĺelle menait dans ce domaine semi-sauvage éloigné de
tout centre. La position pécuniaire dĺIrénée
nĺétait pas sans soucis, il faut le dire. Il prit le parti
dĺaffermer son domaine et de rentrer en France. Une entreprise de
laiterie quĺil fit au Vésinet près Paris ne
réussit pas. Il se réfugia à Puteaux dans un
établissement du même genre, comme employé, et
là, il succomba le 1904 à une congestion pulmonaire. Ś
NDLA.]
2° Hélène
[née le 17 août 1853. Ś
NDLA.] a épousé Albert
Baril [le 1er juin 1874. Ś NDLA.],
homme honnête et droit, qui a
perdu malheureusement la majeure partie de son avoir dans la faillite
de son beau-père Alfred Perret, dĺoù des dissentiments
pénibles.
Ils ont eu trois enfants : 1° Paul [né le 27 avril 1875. Ś NDLA.], mort à 15 ans [le 16
février 1890. Ś NDLA.] à
la suite dĺune très longue maladie de langueur à
Menton, où sa mère lĺavait courageusement
accompagné pendant lĺhiver.
2° Marguerite [née le 10 août 1876. Ś NDLA.],
bonne jeune fille, toute
dévouée à aider sa
mère.
3° Antoinette [née le 25 janvier 1878. Ś NDLA.],
très instruite et très
intelligente.
3° Marthe
Perret, née le 27 septembre
1854. Religieuse du Sacré-Cťur, fille intelligente,
secrétaire de la supérieure du couvent de
Bordeaux.
Savant, homme dĺétudes, médecin des
hôpitaux et professeur à la faculté de
médecine de Lyon. Sĺest marié contre lĺassentiment de
notre père et de toute la famille. Nĺa pas dĺenfants,
heureusement.
Après une jeunesse qui nĺavait pas donné
satisfaction à nos parents, il fit un acte bien louable en
sĺengageant pour exempter du service militaire son frère
Valéry. Avec quelques protections nous réussîmes
à le faire entrer dans le service des vivres, où sa
belle plume et son aptitude à la comptabilité lui ont
valu de faire son temps de service dĺune façon honorable.
À partir de ce moment, ses idées changèrent
complètement et il revint dans le droit chemin. Lorsquĺil
sortit de lĺarmée, il resta quelque temps dans la maison de
notre frère Valéry à Sète, puis il
préféra venir me rejoindre ; enfin, comme je ne pouvais
pas lui faire une position qui lui permît de sĺétablir,
il entra à la succursale du Comptoir dĺescompte à Lyon
par la protection de nos cousins Eymard. Pendant près de vingt
ans, il a occupé là le poste de confiance de caissier
des titres. Mais cette fonction le confinait dans un bureau en
sous-sol très malsain, hors duquel cependant il se trouvait
mal à lĺaise au grand air. Il a contracté là une
maladie de poitrine dont il a fini par mourir en
1891.
En 1873, il avait épousé Jeanne Pin
[(décédée le 8
septembre 1902). Ś NDLA.], douce,
vertueuse et dévouée femme, qui lui a bien donné
tout le bonheur compatible avec une situation médiocre. Il a
laissé deux enfants :
ľ
Jean, né le *** 1877, sĺannonce garçon
dĺintelligence et de cťur. Il fait son chemin dans la maison
où il a été placé par la protection de
notre cousine Émilie, femme de René Eymard.
[Marié le *** à
Amélie Gignoux ; leur premier enfant, mal
conformé, nĺa vécu que quelques mois. Ś
NDLA.]
ľ
Marguerite, née le 13 août 1875, destinée
à lĺenseignement, paraît y avoir
aptitude.
En attendant que ces doux enfants puissent soutenir leur
mère, les familles Eymard et Mayet subviennent à ses
besoins.
Nature vive, ardente et
intelligente.
Elle était sur le point de se marier en 1857
quand survinrent les malheurs de notre père. Pour ne pas le
laisser seul, elle tint à le rejoindre à Paris,
accompagnée de notre grand-tante Fanny Morizot. Quelque temps
après, mise au courant avant nous du mariage de notre tante
avec notre père, elle en conçut un vif chagrin. Sentant
que son rôle auprès de lui était fini, elle entra
dans la congrégation des Servantes du Saint Sacrement
fondée par le père Eymard (qui nĺétait pas notre
parent), très digne prêtre, dĺimagination un peu
ardente, mais qui a laissé une réputation de
réelle sainteté.
Cette congrégation, établie à Paris
faubourg Saint-Jacques, eut des débuts pénibles et ma
chère petite sťur y pratiqua forcément la vertu de
pauvreté. Un peu plus tard, un legs important fait par une
personne pieuse dĺAngers aux Servantes du Saint Sacrement les sortit
de la gêne et leur permit de fonder une maison dans cette
ville, où ma sťur fut envoyée. Deux fois, dans mes
voyages dĺaffaires, jĺai eu le bonheur de lĺy voir heureuse,
entourée de lĺaffection de ses compagnes, quĺelle
égayait par son naturel
enjoué.
Elle avait eu toujours une excellente santé. Qui
eût pu prévoir alors sa fin prématurée ?
Au printemps de 1869, elle se plaignit dĺun mal bizarre qui fut
reconnu plus tard être un kyste interne. Une opération
devint nécessaire ; un chirurgien renommé en fut
chargé ; mon frère Octave se rendit à Angers
pour y aider. Elle semblait avoir parfaitement réussi, quand
deux jours après, la pauvre enfant fut prise dĺune syncope et
rendit à Dieu sa belle âme.
Averti par dépêche, jĺarrivai à
Angers avant ses obsèques, bien touchantes au milieu de ses
compagnes éplorées. Seul avec le jardinier de la
maison, jĺaccompagnai ses restes au cimetière dĺAngers
à la sépulture de la
communauté.
Quelques années plus tard, de nouveau de passage
dans cette ville, jĺai pu revoir la supérieure et apprendre
dĺelle quel vide ma sťur avait laissé dans cette maison
quĺelle animait de son activité et de son enjouement. Je fus
ensuite mĺagenouiller sur sa tombe, lĺimplorant plutôt que
priant pour elle.
Il eut pour parrain M. Gaufre,
intéressé dans la maison de commerce de notre
père, qui, venant à mourir assez jeune, lui
légua 20 000 francs, comme marque de gratitude envers la
famille à laquelle il devait sa
fortune.
Valéry eut une enfance débile ; il ne prit
le dessus que grâce aux soins dévoués de la bonne
Madeleine, ancienne nourrice de ma sťur Marie, restée au
service de nos parents.
Il nĺy a rien de saillant à dire de sa jeunesse,
sauf son goût prononcé pour les sciences naturelles, qui
furent ses seuls divertissements sous lĺimpulsion du savant
M. Mulsant, notre voisin.
Il nĺavait pas fini ses études quand survinrent
les malheurs de notre famille. M. Noilly, ancien ami de mon
père, mĺoffrit généreusement de le prendre comme
apprenti commis dans son importante maison fabrique de liqueurs, en
lui donnant de suite un appointement de 1 200 francs. Il passa
là trois années pénibles sous les ordres dĺun
gérant de cette maison, très dur pour ses
employés. Jĺai dit plus haut comment il fut appelé
à Sète pour fonder la maison en partie dirigée
par mon père, puis bientôt compromise par de nouvelles
imprudences. Après le départ de mon père pour
Perpignan, Valéry lutta quelque temps encore
désespérément, mais inutilement, pour se
relever. Il fut finalement amené à une faillite non
déshonorante, puisque ses causes ne lui étaient pas
personnelles. À grand-peine il obtint un concordat de ses
créanciers, grâce à lĺintervention de nos oncles
Eymard. Puis il entra dans une maison de Béziers pour y faire
la correspondance. Mais ce travail était peu dans ses
goûts. Il sollicita et obtint par lĺappui de plusieurs savants,
ses amis, la chaire de zoologie à lĺécole dĺagriculture
de Montpellier. Déjà, en effet, il sĺétait fait
connaître par dĺimportants travaux dĺentomologie. Mais il ne
tarda pas à sentir que son avenir serait barré par ce
fait quĺil nĺavait aucun grade universitaire. Avec un grand courage,
à 40 ans, il se remit à lĺétude et enleva le
diplôme de licencié ès sciences naturelles
à la faculté des sciences de
Montpellier.
Il nĺétait pas bachelier, mais la
notoriété quĺil avait déjà acquise dans
le monde scientifique par ses travaux entomologiques lui avait valu
lĺappui de plusieurs personnages marquants qui lui obtinrent la
dispense, toujours difficile à avoir, de ce premier
grade.
Il a fourni depuis une honorable carrière dans ce
poste de professeur à lĺécole dĺagriculture de
Montpellier, continuant ses travaux principalement sur tous les
ennemis de la vigne. Il les a résumés en un volume
devenu classique chez les viticulteurs.
En 1834 il fit partie dĺune commission envoyée en
Tunisie par le Gouvernement pour étudier les ressources de ce
pays. Il sĺy occupa spécialement de la zoologie et
rédigea au retour ses observations et ses souvenirs de voyage
en un volume fort intéressant.
Il avait épousé en 1863 (16 avril), au
moment où il semblait que ses affaires à Sète
pouvaient prospérer, Mlle Adèle Taupin, dĺune famille
lyonnaise transplantée à Paris. Ce mariage se fit par
lĺintermédiaire de la famille Pin, qui occupait le principal
appartement de notre maison port Neuville. Notre chère
belle-sťur Adèle a été le soutien de son mari
dans les dures épreuves quĺil a subies. Elle a fait preuve en
toutes circonstances du plus grand dévouement et de la plus
grande abnégation. Sa santé a été
très souvent mauvaise, elle nĺa pas eu dĺautre enfant quĺune
fille Juliette, ma filleule [née
à Sète le 19 juillet 1864. Ś NDLA.], mariée à Léon Cazalis,
contrôleur des contributions directes à Montpellier. Ce
jeune ménage a actuellement deux fils : Jean [(né le 12 septembre 1891). Ś NDLA.]
et Pierre [(né le 15 décembre 1892). Ś NDLA.]
; mais il est bien
éprouvé par le très faible tempérament de
Juliette.
Comme lĺindique le tableau de notre famille, plusieurs
de mes frères et sťurs sont morts tout à fait en bas
âge ; je ne puis mentionner que les dates de naissance de ces
petits anges et celles où ils se sont envolés au
ciel.
Jĺai au contraire à signaler la profonde douleur
que causa la mort de mon petit frère Paul à toute la
famille, spécialement à ma sťur Adèle et
à moi.
Nous nous occupions en effet beaucoup de ce cher petit,
dont lĺintelligence très développée
annonçait une nature dĺélite. Notre pauvre mère
était souvent malade ; nous nous efforcions de la
suppléer dans le commencement dĺéducation de notre
petit frère. La maladie qui lĺa emporté fut longue et
douloureuse. Jĺétais alors employé dans la maison de
banque Morin-Pons. Deux fois par jour, ma mère mĺenvoyait des
bulletins me tenant au courant des alternatives du terrible mal qui
finit par nous ravir ce cher enfant. Jĺai laissé quelques-uns
de ces bulletins joints aux lettres de ma mère ; ils
témoignent de ce quĺétait son cťur. La douleur
dĺAdèle et la mienne furent inexprimables, on ne put nous
arracher du lit de ce pauvre petit, nous tînmes à
lĺensevelir nous-mêmes. À ce moment, mon père
était en voyage. On nĺavait pas pu le prévenir du
malheur qui nous frappait. Je fus, en bateau à vapeur,
jusquĺà Chalon pour le lui apprendre et revenir avec
lui.
né le 2 septembre 1846, décédé à Amélie-les-Bains le 21 mars 1877
Il avait vingt-et-un ans de moins que moi. Aidé
de votre mère, je lĺai élevé, je puis dire comme
mon fils, après le départ de Lyon de mon père.
Sa mort a été lĺune des peines les plus vives de ma
vie. Tout enfant, il montra le plus heureux naturel. Au moment de mon
mariage, il avait 7 ans ; son air doux et intelligent séduisit
de suite votre mère, qui le soigna comme son enfant. Ses
études à lĺinstitution dite des Chartreux à Lyon
furent brillantes. Il en sortit bachelier ès lettres et ayant
remporté les premiers prix de la classe de philosophie. Ses
tendances artistiques lĺauraient porté à lĺarchitecture
; mais une carrière dont les abords sont si longs ne pouvait
pas donner satisfaction à son ardent désir de
travailler au relèvement de la famille. Je le plaçai
donc, sur sa demande, dans une maison de banque de Lyon, Droche &
Robin. Puis il trouva à Villefranche chez MM. Bourgeot et
Poulet, également banquiers, un poste plus lucratif.
Après le départ de notre père de Sète,
mon frère Valéry, qui appréciait son
intelligence, lĺappela pour lĺaider. Bien souvent, il allait à
Perpignan voir notre père. Il lĺassista à ses derniers
moments avec nos deux frères Octave et Valéry. Puis il
resta auprès de notre tante, mourante elle-même, lui
ferma les yeux et ramena ses restes à Lyon au commencement de
1870.
Revenu à Sète, il continua à
travailler avec notre frère
Valéry.
Au moment de la guerre, il nĺétait soumis
à aucun service militaire, ayant pu, au tirage au sort, payer
un remplaçant grâce à un prêt
généreux de notre oncle Valéry Eymard. Mais il
avait lĺâme trop ardente pour profiter de cette situation au
milieu de lĺémoi général. Il sĺengagea dans la
garde nationale mobile et partit avec ses deux cousins, Joseph et
Hugues Eymard, qui étaient tenus, eux, de faire partie de
cette troupe improvisée. Elle fut rassemblée pour le
département du Rhône au camp de Sathonay. Pendant
quelques jours, nous pûmes aller voir là nos jeunes
gens, pleins de courage, mais non dĺentrain et dĺillusions, car
déjà les revers se succédaient. Cĺétait
pitié de voir lĺétat de cette jeune troupe, dont tout
lĺuniforme consistait en une blouse bleue bordée de rouge et
un képi. Toute famille ayant à peu près le
nécessaire suppléa à lĺinsuffisance des
vêtements et des chaussures. Mais quand fut donné
à ces pauvres jeunes gens lĺordre de partir pour Belfort, bon
nombre, qui nĺavaient pas de ressources, se mirent en route à
lĺentrée de lĺhiver à peine vêtus. Nous
fûmes heureux dĺapprendre quĺils étaient envoyés
dans cette place réputée imprenable et quĺon savait
bien munie. Nous étions loin de prévoir combien leur
sort serait dur au contraire. Assez longtemps, nous pûmes
recevoir leurs lettres et leur écrire. Mais, à mesure
que lĺinvasion allemande gagnait le Sud-Est, elles devinrent plus
rares, puis manquèrent tout à fait. Cĺétait le
commencement des angoisses des familles lyonnaises. Au bout de quinze
jours, qui nous parurent des mois, nous reçûmes tout
à coup, par la Suisse, de ces braves enfants, des lettres
écrites très fin sur de petits papiers. Elles avaient
été apportées au village de Bonson, près
de Porrentruy, par une bonne vieille femme qui les avait cousues dans
les doublures de sa robe et avait réussi à franchir les
lignes ennemies. Pendant plus de deux mois, elle continua ce
dangereux manège, marchant dans la neige, et gagnant les
sentinelles allemandes en leur donnant des cigares, puis rapportant
dans Belfort notre correspondance. Un brave aubergiste de Bonson
sĺétait chargé dĺêtre le dépositaire, dans
les deux sens, de ces précieuses lettres. Jĺen conserve
quelques-unes de Benjamin.
Rien ne rapproche comme les épreuves. Toutes les
familles lyonnaises qui avaient de leurs enfants dans Belfort,
pauvres et riches, se communiquaient les lettres ainsi reçues.
Jĺoffris dĺaller par la Suisse porter à lĺaubergiste les
remerciements de tous et le remboursement de ses frais. On se cotisa
pour y joindre un cadeau. Je fis ce voyage par un froid terrible.
Mais pour moi, la peine physique fut peu de chose à
côté de celle morale. De Bonson, jĺentendis gronder dans
les montagnes les coups de canon des assiégeants et des
assiégés. Les avant-postes allemands touchaient la
frontière, jusquĺà laquelle je mĺavançai.
Quelques kilomètres seulement, impossibles à franchir,
me séparaient de ceux dont la vie nous était si
chère. Un bataillon de lĺarmée suisse était
là pour interner les déserteurs allemands, très
nombreux. Ils encombraient le village de Bonson et racontaient les
souffrances des assaillants, la résistance
héroïque de nos braves moblots, leurs sorties
hardies sous la protection des canons de la
place.
Nous sûmes plus tard que Benjamin sĺy était
montré aussi courageux quĺaudacieux. Cĺest lui, en
qualité de sergent à la tête dĺune petite
escouade, qui tomba une fois sur une grand-garde allemande,
occupée à préparer le café. Nos Prussiens
détalèrent prestement à lĺapproche des mobiles.
Benjamin, à ce moment, marchant en avant, se retourna vers ses
hommes et leur dit gaîment : « Eh, les gones de Lyon
! Voilà votre café servi. » Propos bien
français que ses camarades nous ont transmis. Il avait
rapporté de cette équipée plusieurs
pièces de fourniment laissées par les Prussiens dans
leur fuite.
Ce fut ensuite dans une autre sortie quĺil fut
grièvement blessé, au bas des reins, par une balle.
Rapporté dans Belfort par ses cousins, il fut mis à
lĺambulance. Il tenait bien à expliquer que cĺétait en
faisant face à lĺennemi, couché à plat ventre
dans une embuscade, quĺil avait été ainsi blessé
dĺune manière peu honorable en apparence. À la paix, sa
vaillance lui valut la médaille militaire. Je revins de Bonson
sans avoir pu voir notre pauvre messagère. Elle put encore une
fois pénétrer dans Belfort ; puis on ne la revit plus.
Périt-elle de froid, ou fut-elle tuée par les Allemands
? On ne lĺa jamais su. Que de dévouements obscurs, dans ces
moments terribles, nĺont reçu leur récompense que dans
lĺautre monde !
Enfin lĺarmistice arriva et, bien quĺil stipulât
lĺoccupation momentanée de Belfort par les Allemands, nous
pûmes avoir des nouvelles de nos braves jeunes gens.
Grâce sans doute aux prières de leur
vénérée grand-mère, ils étaient
tous trois vivants, et elle allait avoir la joie de les serrer de
nouveau dans ses bras.
La blessure de Benjamin était en voie de
guérison ; mais il était très
éprouvé par son séjour dans une casemate humide
et dans lĺimpuissance de partir à pied avec les camarades. Le
service des chemins de fer dans lĺEst était suspendu. Une
bonne mère lyonnaise, Mme Jenoudet, qui nĺavait pas
quitté son fils également malade à Belfort, loua
une petite voiture et entreprit de ramener ces deux pauvres enfants.
Benjamin était dans un tel état dĺabattement quĺil
refusait dĺabord de se laisser emmener, disant quĺil serait
peut-être bien soigné par les Prussiens. Mme Jenoudet
insista et finit par le déterminer. Quelle reconnaissance nous
dûmes à cette bonne dame ! [(qui, plus tard, en Algérie, a été
victime dĺune insurrection arabe). Ś
NDLA.]
Enfin nous le revîmes, mais dans quel état
! Pâle, maigri, ses vêtements usés, en
lambeaux !ů
Presque en même temps arrivait par étapes
à Lyon cette glorieuse garnison de Belfort, dont
lĺentrée fut un triomphe. La garde nationale faisait la haie
pour la recevoir. Bruno et Paul peuvent se souvenir que je les avais
emmenés dans les rangs avec moi pour quĺils fussent
témoins de ce spectacle
mémorable.
Joseph Eymard, aussi pauvrement vêtu que les
autres, marchait à la tête de sa compagnie, sonnant
fièrement du clairon.
Benjamin, ne pouvant pas prendre part à ce
triomphe, voulut du moins faire un acte de courage de plus. Notre
lâche municipalité lyonnaise avait laissé sur le
beffroi de lĺhôtel de ville le drapeau rouge, arboré
depuis la chute de lĺEmpire. Benjamin fit insérer dans les
journaux de la ville une protestation vibrante dĺénergie
contre cette indignité. Jĺen ai conservé un
exemplaire.
Nous lĺentourâmes de tant de soins quĺil se remit
assez promptement et ne tarda pas à aller rejoindre notre
frère Valéry à Sète. Les affaires se
ranimaient ; ils avaient tous deux lĺespoir de relever leur maison,
si meurtrie depuis le départ de notre père pour
Perpignan. Cet espoir fut si bien partagé par quelques amis
quĺils lui facilitèrent un mariage absolument
inespéré. Le 15 mai 1873, il épousa Mlle Marie
Audouard [(née le 15 août
1849). Ś NDLA.], richement dotée
par sa tante, Mme veuve Rouzier. Ce qui était mieux encore que
la fortune, elle lui apportait un cťur dĺor, une vive intelligence et
une réelle piété, dons précieux que
Benjamin se mit à cultiver avec toute son ardeur habituelle.
Il faut ajouter aussi quĺelle était fort jolie. Notre cher
frère trouvait ainsi la récompense bien
méritée de sa vertueuse jeunesse, de son courage et de
son dévouement pour les siens. La Providence lui
ménagea alors quelques années de grand bonheur, pour
terminer sa carrière si bien remplie et si courte,
hélas !
Sa chère Marie lui donna successivement deux
filles : Marguerite [(née le 29
avril 1874). Ś NDLA.] et
Marthe. La
dernière ne vécut que peu de mois et cette perte
assombrit le bonheur du jeune ménage.
Marguerite, après
avoir été longtemps un peu débile, est devenue
une grande et forte fille par les soins de sa mère. Elle
ressemble à son père dĺune façon frappante.
[La santé a depuis gravement
périclité. Ś NDLA.]
La santé de Benjamin paraissait suffisante.
Cependant, il avait conservé de son séjour dans les
casemates de Belfort une certaine faiblesse de poitrine. Avec son
ardeur excessive, il se prodiguait en courses pénibles pour
les affaires. Souvent, il était arrêté par des
refroidissements. Dans le courant de lĺhiver 1876-1877, ces
indispositions devinrent de plus en plus graves. Effrayée, sa
femme lĺemmena à Amélie-les-Bains, espérant le
rétablir. Le hasard voulut que je fisse à ce moment un
voyage dans le Midi pour affaires de ma compagnie. Je poussai
jusquĺà Amélie-les-Bains. Je fus terrifié de
lĺétat de ce cher frère, je mĺefforçai de
dissimuler mes craintes à sa pauvre femme ; les illusions du
mourant la soutenaient elle-même. Il priait Dieu avec ardeur de
lui rendre la santé, se faisant apporter le pain de vie deux
fois la semaine, espérant toujours !
À mon retour par Montpellier, mon frère
Valéry mĺattendait à la gare. Je ne pus retenir mes
larmes. Il comprit, et nous mêlâmes notre
douleur.
Deux semaines après, rentré à
Paris, jĺapprenais par une dépêche que notre cher
frère, en réalité mon fils aîné,
était allé trouver le repos mérité par sa
vie si courte et si bien remplie. Il mourait dans sa
trente-et-unième année.
Marie nous est restée attachée de tout
cťur. Malgré les instances de sa famille, elle nĺa pas voulu
se remarier.
Elle a voué son existence à
lĺéducation de sa fille et à toutes sortes de bonnes
ťuvres.
Les restes de Benjamin furent rapportés à
Béziers, où ses obsèques furent suivies par un
grand concours dĺamis. Son caractère affable, obligeant,
enjoué, lui en avait acquis de très nombreux. Plusieurs
discours furent prononcés sur sa tombe. Il semblait que ce
fût une des notabilités de la ville qui
disparaissait.
Un journal de la localité, que jĺai
conservé, en témoigne.
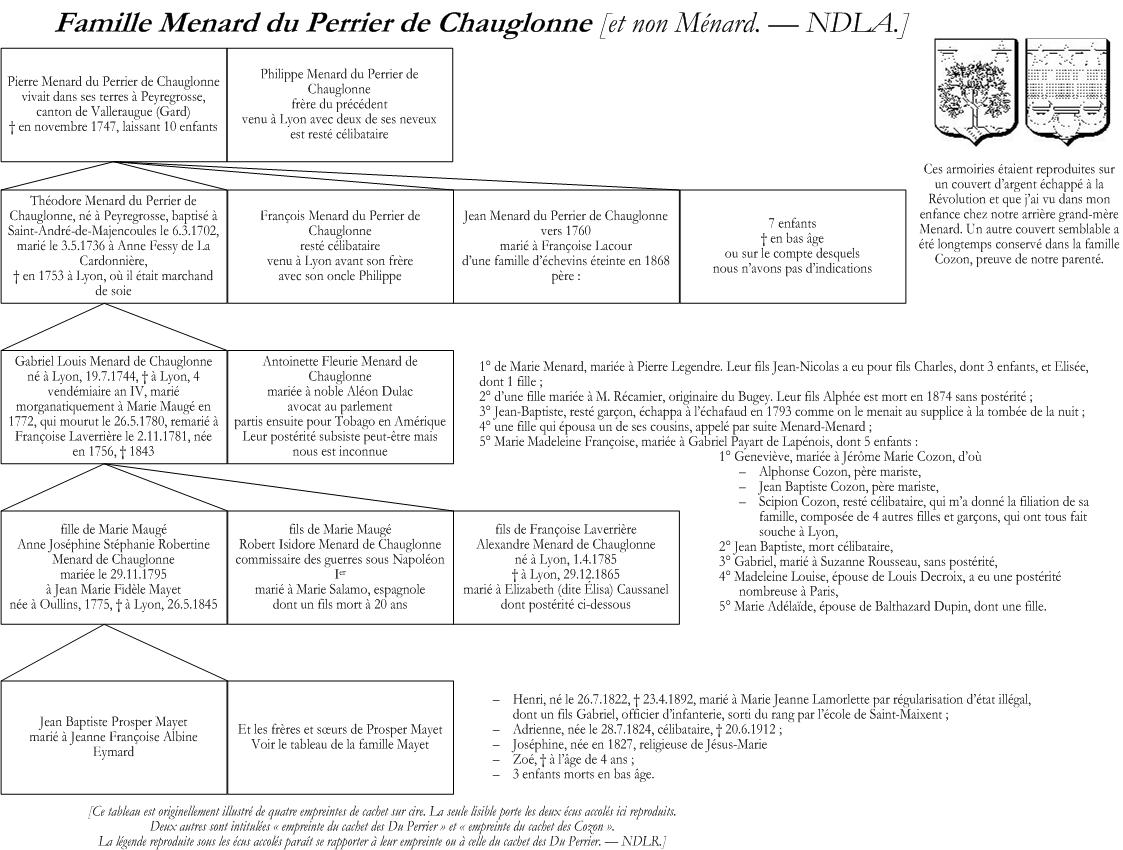
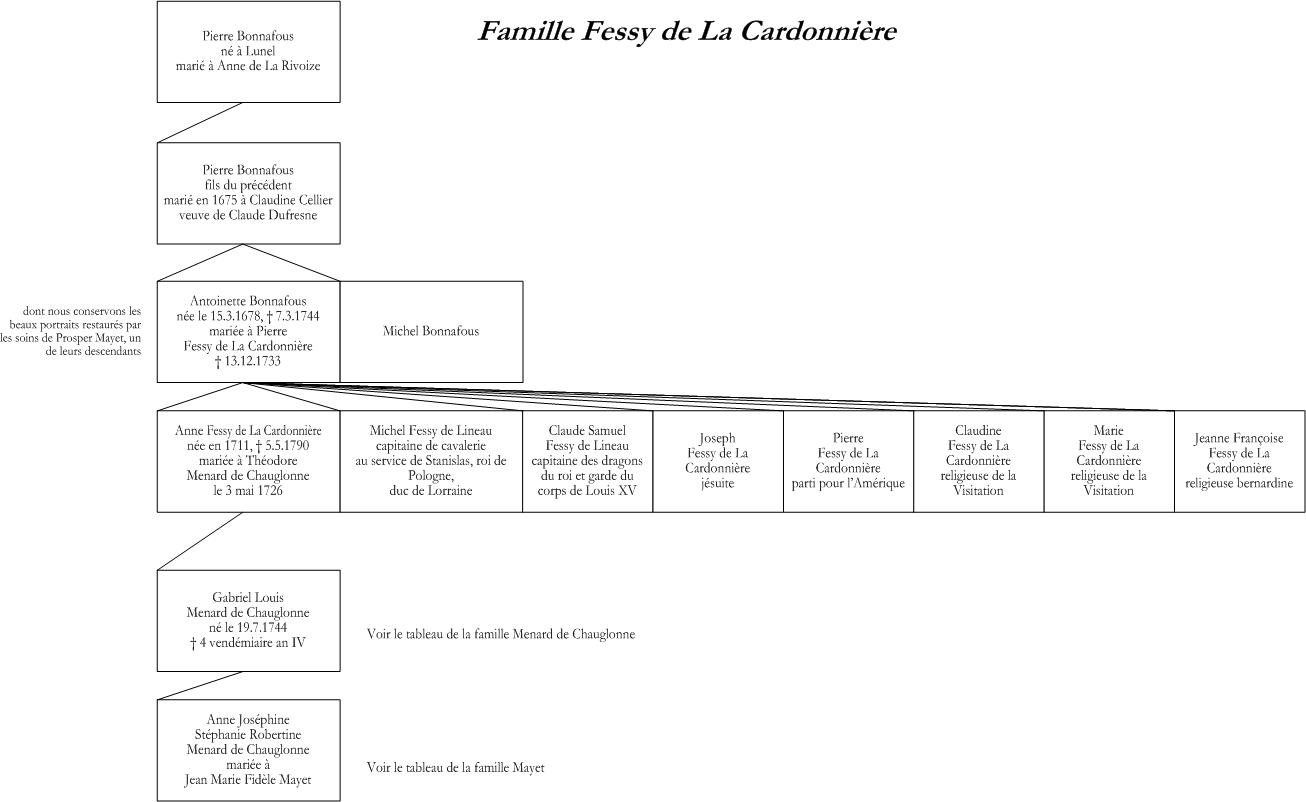
Les tableaux qui précèdent ont
été établis dĺaprès des notes recueillies
en Languedoc par notre cousin Henri Menard de Chauglonne. Ils
donnent, depuis le règne de Louis XIV, la filiation certaine
de cette famille, dont la noblesse remontait plus haut, car des
traditions peu précises disaient que lĺun de ses
ancêtres avait été huguenot, puis avait
abjuré et avait servi dans les armées
dĺHenri IV.
Cĺest sans doute à cette origine militaire que
Théodore Menard du Perrier dut lĺhonneur dĺépouser Anne
Fessy de La Cardonnière, sťur de deux officiers
distingués. Mais lui-même prit une tout autre route ;
car, venu à Lyon pour vendre des soies, principal produit des
domaines de sa famille, il sĺy fixa et continua ce
commerce.
Cependant, son fils [Gabriel Louis. Ś NDLA.] reprit les traditions de ses ancêtres en entrant
dans lĺarmée.
Avant de suivre la branche masculine des Menard, je dois
mĺarrêter à cette famille Fessy de La
Cardonnière, dont la mémoire est heureusement
conservée par les deux magnifiques portraits que nous
possédons et qui sont actuellement à la garde de notre
cousine Adrienne Menard. Quel grand air avaient ces respectables
aïeux ! Nous ne savons rien de leur existence, sinon quĺelle
sĺécoula en Languedoc et que Pierre Fessy était
magistrat. Mais nous pouvons juger du mérite de ce père
et de cette mère par la famille quĺils ont
élevée, composée de notre arrière
aïeule, dĺun officier qui fut au service de Stanislas, duc de
Lorraine, dĺun autre officier garde du corps de Louis XV, dĺun
père jésuite, de trois religieuses, dont deux
visitandines, et dĺun de ces cadets qui furent à la Louisiane
ou au Canada fonder lĺempire colonial de la
France.
On mĺa toujours dit que cĺétait de ces
grands-parents que nous venait le bel exemplaire de lĺAtlas de Vaugondy que nous
possédons.
[Une autre empreinte dĺarmoiries plus compliquées
des Du Perrier mĺa été remise par Gabriel Menard de
Chauglonne, fils dĺHenri. Cet écusson a été
déchiffré par notre cousin Breghot du Lut comme suit :
écartelé 1 et 4 dĺargent au poirier de sinople sur une
terrasse du même, accompagné en chef de deux
étoiles dĺazur, 2 et 3 dĺazur à la fasce dĺor,
accompagné en chef de trois étoiles dĺargent et en
pointe de trois croissants dĺargent posés 2 et
1.
Une tradition conservée verbalement
établit bien notre filiation depuis ces
vénérables aïeux : ma grand-mère Mayet,
née Menard, avait appris à lire sur les genoux de sa
grand-mère, dame Menard née Fessy, qui lui disait, en
lui montrant ces beaux portraits, qui existent encore :
« Joséphine, lisez bien, voyez mon père et ma
mère qui vous regardent. » Cette arrière
grand-mère Menard de Chauglonne était fort instruite,
elle sĺoccupait dĺhistoire naturelle et nous avons contribué,
mon cousin Henri Menard et moi, à achever de dilapider les
restes dĺune collection de coquillages qui venait dĺelle. Ś
NDLA.]
Je reviens à la tige
masculine.
À quel moment les Menard cessèrent-ils de
sĺappeler du Perrier pour prendre le titre de Chauglonne dĺune terre
quĺils avaient acquise dans les Cévennes ? Je lĺignore. Mais,
lorsque Théodore Menard vint sĺétablir à Lyon,
il portait encore le nom du Perrier et son blason figurant un
poirier, accosté de deux étoiles, subsistait encore il
y a peu sur la porte dĺune maison, maintenant détruite, qui
lui avait appartenu, dans la rue dite de lĺArbre sec, nom qui avait
probablement été donné à cette rue
à cause de ce blason. Jĺai vu dans mon enfance chez mon
arrière grand-mère Menard un couvert dĺargent,
échappé à la Révolution, qui portait ce
même écusson. Jĺavais recueilli un cachet qui le
reproduisait et je lĺavais donné à mon cousin Henri
Menard, qui lĺa perdu dans ses campagnes. Mais jĺen conserve
lĺempreinte [ci-jointe. Voir le tableau
qui précède. Ś NDLA.].
né à Lyon le 19 juillet 1744, décédé à Lyon le 4 vendémiaire an IV,
prit la carrière militaire un peu contre le
gré de son père et avait encore plus indisposé
sa famille en faisant un mariage dĺinclination tout à fait
au-dessous de son rang. Marie Maugé, mon arrière
grand-mère, était, dit-on, fille dĺune marchande de
légumes de la place des Jacobins. Elle mourut jeune, laissant
deux enfants : Anne Joséphine, ma grand-mère, et un
fils, Robert Isidore.
Gabriel Louis Menard de Chauglonne, peu après la
mort de sa femme, fit partie de lĺarmée qui conquit
[occupa. Ś NDLA.] la Corse sous Louis XV. Il nĺétait pas du reste
dĺun tempérament belliqueux. Assez homme du monde, il avait de
très bonnes manières. Adroit et minutieux, il excellait
dans les travaux manuels, suivant la mode du temps. Je conserve un
carton dans lequel il fermait ses épaulettes, et quĺil avait
fait en réunissant des cartes à jouer, vrai travail de
patience [qui ne se referait pas
aujourdĺhui. Ś NDLA.].
À sa rentrée en France, il obtint le poste
fort honorable de capitaine du guet de la ville de Lyon. Nous dirions
aujourdĺhui commandant de la garde municipale. Comme tel, il avait un
logement dans un bâtiment appartenant à la ville,
aujourdĺhui détruit et formant une partie de la place des
Cordeliers. On lĺappelait hôtel du Concert en raison de la
salle de musique qui sĺy trouvait. Ce fut là quĺil
épousa en secondes noces Françoise Laverrière (2
novembre 1781), fille dĺun honorable fabricant de passementerie dĺor
et dĺargent à Lyon, née en 1756. Je conserve la copie
de son contrat de mariage. Elle ne lui apportait pas une grosse dot,
mais une vertu éminente, un naturel aimant,
dévoué et surtout raisonnable. Elle éleva comme
une vraie mère les enfants de la première femme de son
mari. Pendant la tourmente révolutionnaire, elle soutint son
courage.
Il avait dû abandonner son poste après le
siège de Lyon et resta quelque temps retiré dans la
maison de campagne quĺil possédait à
Oullins.
Deux de ses amis intimes et anciens compagnons dĺarmes,
MM. Montellier et Beckner, périrent sur lĺéchafaud
à ce moment. Lui-même, vers la fin de la Terreur,
dénoncé comme suspect, avait dû quitter Oullins
et sĺétait réfugié à Lyon chez des
parents de sa femme. On le trouva mort dĺune attaque ou dĺasphyxie
dans un placard où il sĺétait
caché.
Je reviens à Françoise Laverrière,
que jĺai cru toute mon enfance être ma vraie arrière
grand-mère, tant elle était aimée et
vénérée par toute la famille de mon père,
spécialement par ma grand-mère Mayet, qui lĺappelait
maman et nĺavait aucun souvenir de sa vraie mère. Mon
père la considérait tellement comme sa
grand-mère quĺil avait toujours vécu dans la plus
grande intimité avec son neveu Alexandre Laverrière et
ses cousines les bonnes demoiselles Bellacla, vieilles et
respectables institutrices, qui étaient absolument comme de
notre famille.
Françoise Laverrière avait pour
frère un architecte de quelque valeur, ami intime, pendant les
années qui ont précédé la
Révolution, de lĺingénieur Perrache, qui conçut
et exécuta le hardi projet de rejeter le confluent du
Rhône et de la Saône au moyen dĺune digue, dite
chaussée Perrache, bien au-delà des remparts dĺAinay.
Pendant ce travail, la famille de lĺingénieur occupait une
maison de campagne située dans lĺîle Moniat, qui se
trouva par le fait reliée à la presquĺîle de
Lyon. Cette maison fut ruinée pendant le siège de
1793.
Jĺai souvenir que notre arrière grand-mère
(de nom), nous menant promener avec ma sťur Adèle, nous
conduisit un jour devant ces ruines et, nous montrant une bretagne
[taque (Nizier
du Puitspelu,
Le Littré de la
Grand-Côte). Ś NDLR.]
en fonte restée adossée
à un mur, nous dit : « Jĺai travaillé souvent
devant cette cheminée avec la famille
Perrache. »
Au moment où elle évoquait ce souvenir,
elle habitait rue du Bât-dĺArgent, dans une maison appartenant
à ses deux vieilles amies Mmes Montellier et Beckner,
avec lesquelles elle était restée dans une grande
intimité, toutes trois veuves de victimes de la
Révolution.
Un peu plus tard, ma satisfaction, les jours de
congés, en sortant du collège, était de prendre
cette bonne grand-mère pour lĺamener à la maison le
reste de la journée.
Elle acheva par une sainte mort, à 87 ans, sa
carrière, si traversée, puis remplie les
dernières années par lĺexercice de la charité ;
elle était infatigable à la visite des
pauvres.
Cĺétait une femme de sens et de cťur,
plutôt que dĺesprit brillant. Elle aimait les enfants et savait
sĺen faire aimer. Elle était de ceux qui ne sĺarrêtent
pas à rappeler les malheurs quĺils ont subis, et certes, elle
en avait éprouvé dĺépouvantables pendant la
Terreur. Sortie dĺune famille bourgeoise, bourgeoise elle
était restée, quoique mariée à un
gentilhomme. Elle ne se faisait appeler que « Mme
Menard » et avait fait si bien oublier le nom de Chauglonne
que dans la famille, on lĺignorait presque et quĺon fut
jusquĺà trouver mauvais, bien à tort, que mon cousin
Henri le reprît, une fois militaire, en quoi il eut
parfaitement raison. Il ne faisait du reste que se conformer à
son état civil, établi par lĺacte de baptême de
son père sur les registres de la paroisse Saint-Nizier
transferés aux archives de la ville, où je lĺai
lu.
La mort de cette bonne grand-mère a
été pour nous un grand deuil. Ses restes reposent dans
notre tombe de famille, où mon père a fait inhumer
aussi son neveu Alexandre Laverrière, quĺil traitait comme son
frère.
[Je conserve son portrait très ressemblant fait
par M. Tissot, mon maître de dessin. Ś
NDLA.]
Cĺétait une femme de mťurs austères, dĺune
foi vive, mais empreinte dĺun peu dĺesprit janséniste, qui lui
venait probablement de sa grand-mère née Fessy de La
Cardonnière, laquelle sĺétait occupée de son
éducation, comme je lĺai dit plus
haut.
Fervente chrétienne, donnant chaque jour beaucoup
de temps à la prière, elle nĺallait jamais, chose
bizarre, le dimanche, quĺà la messe de midi, et ne
sĺapprochait des sacrements quĺà Pâques et à
Noël. Elle avait compensé par la lecture lĺinsuffisance
de son éducation, interrompue par la
Terreur.
Fille de noble et fort belle, elle avait fait un mariage
dĺinclination en épousant mon grand-père, dĺune famille
tout à fait roturière. Cette alliance montre bien
à quel point toutes les classes furent confondues au sortir de
la Révolution.
Elle remplit toujours ses devoirs dĺépouse et de
mère avec une haute vertu, une abnégation sans borne ;
mais elle nĺavait pas tardé à être assez en froid
avec la famille de son mari, à lĺexception de son
beau-frère lĺecclésiastique, dont elle
appréciait la distinction. Pleine dĺesprit, très vive
à la répartie, elle souffrait de la vulgarité de
ses belles-sťurs et le laissait trop voir.
Quand vinrent les revers de son mari, elle fit preuve
dĺune énergie et dĺune intelligence hors ligne. À aucun
prix elle ne voulut se résigner à priver ses fils
dĺinstruction. Voici ce quĺelle fit pour la leur assurer : tandis que
son mari se résignait à remplir un modeste emploi
à Castelsarrasin comme je lĺai dit, elle laissait ses fils
à sa mère, partait pour Paris, emportant pour toute
ressource un couvert dĺargent à vendre, ouvrait pour subsister
une boutique de mercerie et bonneterie dans le passage Delorme (entre
la rue de Rivoli et la rue Saint-Honoré. Bien souvent jĺy
passe, cherchant cette boutique, point de départ de la
restauration de notre famille), puis, munie de lettres de
recommandation de Mme Récamier et de M. Ampère,
lĺillustre savant, deux de nos sommités lyonnaises, elle
sollicitait pour son mari la place dĺéconome du lycée
de Lyon, où elle espérait ainsi faire élever ses
deux fils gratuitement. Son attente fut longue. Mme de Fontanes,
femme du ministre de lĺInstruction publique, à laquelle elle
avait été recommandée, fut touchée de son
héroïque dévouement et fit tout son possible pour
lĺaider à atteindre son but. En attendant, elle se faisait
honneur de produire cette jeune femme, belle et spirituelle. Elle la
recevait dans son salon, alors fréquenté par les
illustrations de lĺépoque, entre autres Mme de Staël, non
encore disgraciée à ce moment. Il était
intéressant de mettre ma grand-mère sur ses souvenirs
de ce temps-là ; mais elle ne sĺy prêtait que dans
lĺintimité la plus étroite. Je conserve une petite
lettre de Mme de Fontanes lĺassurant de sa sympathie et lĺengageant
à la patience.
Enfin le terme de ses peines arriva. Mon
grand-père fut nommé économe du lycée de
Lyon et quitta Castelsarrasin. De son coté, ma
grand-mère rentrait au milieu des siens et la famille se
trouvait ainsi reconstituée dans des conditions honorables,
grâce à son intelligence et à son énergie.
Son séjour à Paris avait duré un an. Que de
constance ne lui fallut-il pas pour poursuivre aussi longtemps son
dessein ? Je puis donc bien constater que notre famille lui doit de
ne pas être redescendue au niveau de quelques-uns de nos
parents, restés dans la classe
ouvrière.
Elle ramenait sa fille Adèle, qui avait fait sa
première communion à Paris, comme je lĺai dit plus
haut, mais qui paraissait déjà atteinte de la maladie
de langueur qui devait lĺemporter.
À partir de ce moment, lĺexistence de ma
grand-mère resta inséparablement liée à
celle de mon père, qui avait si bien justifié ce
quĺelle avait fait pour lui.
Après son mariage, elle vécut aidant ma
mère à élever sa nombreuse famille. Nous
lĺappelions la bonne-mère
pour la distinguer de lĺarrière
grand-mère Menard et de la mère de ma mère, qui
était la bonne-maman.
Je conserve à sa mémoire toute la
reconnaissance que je dois à ses bons soins pendant mes
études.
Ses dernières années furent
pénibles au point de vue de la santé ; elle souffrait
constamment de maux dĺestomac et ne se soutint que par un
régime des plus rigoureux.
Elle finit sa carrière à 70 ans dans les
sentiments dĺune austère
piété.
[Je conserve son portrait, au crayon, par
M. Tissot, mon maître de dessin, fait peu de temps avant
sa mort. Il est ressemblant, mais moins bien réussi que celui
de grand-mère Menard. Ś NDLA.]
a mené une existence aventureuse, composée
dĺalternatives de fortune et de
misère.
Commissaire des guerres sous Napoléon
Ier,
il avait épousé en Espagne Marie Salamo, dĺune bonne
famille mais qui passa avec lui une existence fort agitée et
souvent malheureuse. À quelle époque finit la
carrière de cette sorte dĺaventurier ? Je
lĺignore.
Sa veuve était restée en correspondance
avec mon père, qui plus dĺune fois est venu à son aide.
Elle avait un fils qui paraissait capable de la soutenir ; ce jeune
homme de mérite fut enlevé à sa mère par
la typhoïde à 20 ans. Elle-même succomba peu
après à Perpignan, où elle vivait
retirée, victime du choléra de
1832.
né le 1er avril 1785 à Lyon, décédé le 29 décembre 1865 à Lyon
La mémoire de ce bon oncle doit être
conservée, tant il était aimable, obligeant, serviable.
Mais il faut dire quĺil joignait à ces qualités une
inconcevable insouciance des nécessités de la vie.
Cĺétait un gentil homme de lĺautre siècle, moins
lĺincrédulité, car il fut toujours bon
chrétien.
Établi fabricant dĺétoffes de soie, il ne
tarda pas à compromettre sa fortune par son incurie.
Très adroit dans tout art manuel, il négligeait ses
affaires pour passer son temps à de menus travaux, souvent
inutiles, car il nĺavait pas dĺinstruction
scientifique.
Il quitta Lyon pour entrer intéressé dans
une fabrique de rubans à Saint-Étienne, où il
nĺeut pas plus de succès. Ce fut là quĺil perdit sa
femme, Élisa Caussanel, dont la vie très vertueuse
sĺétait écoulée dans la gêne, et qui lui
laissa quatre enfants vivants, après en avoir perdu trois en
bas âge.
Il était dans lĺimpuissance dĺélever cette
famille. On se la partagea. Sa belle-mère, la respectable Mme
Caussanel, se chargea dĺAdrienne, qui en retour entoura de ses soins
cette vénérable grand-mère pendant sa longue
vieillesse. Mon père fit élever Henri, partie au petit
séminaire de Saint-Jean, partie ensuite comme externe au
collège de Lyon avec moi.
La grand-mère Menard garda la petite Zoé,
qui mourut à 4 ans. Enfin, on obtint pour Joséphine
lĺéducation presque gratuite au couvent de Jésus-Marie
à Chazay, où elle prit elle-même lĺhabit
religieux une fois grande, après avoir vécu quelque
temps avec son père.
Quant au pauvre oncle Menard, il vécut quelques
années tristement seul à Terrenoire, où lĺun de
ses amis, M. Génissier, directeur de la Compagnie des
forges, alors florissante, lui avait assuré un modeste
emploi.
Mon père prit son isolement en pitié et
finit par obtenir de son associé, M. Bunod, de lui donner
à tenir la caisse de la maison Mayet et Bunod ; emploi qui,
à vrai dire, nĺétait guère suffisant pour
occuper un homme. Il le garda jusquĺau départ de mon
père, bien soigné par sa fille Adrienne, qui
était venue, après la mort de sa grand-mère,
remplacer sa sťur Joséphine auprès de
lui.
Même quand survint la catastrophe de la chute de
notre maison, il ne parut sĺinquiéter de rien. Dès
longtemps, il avait pris lĺhabitude de ne pas sĺarrêter aux
choses pénibles, évitant même dĺen parler. Nous
convînmes en famille de lui donner un appartement dans la
maison que nous possédions indivise rue de lĺAnnonciade ;
puis, quand elle fut vendue, nous continuâmes à payer
son loyer.
[Avec lĺappui de quelques amis, il obtint la place peu
lucrative et peu absorbante de caissier dans une étude de
notaire, et la garda deux ou trois ans. Mais ses facultés
baissèrent de plus en plus et il ne tarda pas à ne plus
pouvoir remplir cet emploi. Ś NDLA.]
Adrienne ajouta à ses minces ressources un peu de
travail dĺaiguille. La bonne Annette, ancienne domestique de Mme
Caussanel, continua à le servir par dévouement. Le bon
oncle vécut ainsi tranquille pendant huit ans, sans
paraître se préoccuper de savoir dĺoù lui venait
le demi-bien-être dont il jouissait.
Les derniers temps de sa vie, tant quĺil put marcher, il
se rendait assidûment aux offices des pères capucins,
sĺétant fait agréger au tiers-ordre franciscain. Il
mourut à 80 ans, regretté de tout le monde,
malgré son peu de cervelle, tant il était bon et
affable. Ses petites manies, ses idées souvent enfantines et
son amabilité resteront comme un des bons souvenirs de notre
famille.
Nous avons son portrait-carte pris avec sa fille
Adrienne. Je conserve de plus un portrait de lui plus ancien sur
plaque daguerréotype.
Adrienne Menard de Chauglonne,
fille aînée du précédent et
dĺÉlisa Caussanel, née le 28 juillet
1824.
Après avoir soigné, comme je lĺai dit plus
haut, sa grand-mère Caussanel puis son père
jusquĺà leur mort, elle a encore rendu le même service
à Mme veuve Laverrière, sa cousine, qui lĺa mise par
son testament un peu au-dessus du besoin. Elle remplit maintenant de
bonnes ťuvres envers les pauvres sa vie précédemment
dévouée à ces trois
vieillards.
Toute son existence nĺa été ainsi quĺun
dévouement continu. Actuellement encore, cĺest à elle
quĺon sĺadresse quand on a besoin dĺaide ou de
secours.
Henri Menard de Chauglonne,
né à Lyon le 24 juillet 1822,
décédé à Montpellier le 23 avril 1892,
fils dĺAlexandre Menard, a été élevé en
partie avec moi par mon père.
Placé dans une maison de banque, où il
paraissait avoir de lĺavenir, il eut des difficultés avec ses
chefs et prit le parti dĺaller rejoindre un de ses cousins Desarbres
négociant en Algérie. Nĺayant pas pu non plus
sĺentendre avec lui, il sĺengagea et sut faire son chemin dans
lĺarmée. Sa facilité à apprendre les langues lui
permit dĺarriver à parler parfaitement lĺarabe, ce qui lui
valut de franchir rapidement les premiers grades dans les bureaux
arabes.
Au siège de Sébastopol, au Mexique et
pendant la guerre de 1870-1871, il se distingua par son courage.
Prisonnier à Metz, il passa son temps de captivité
à Hambourg, ayant le grade de capitaine. À la paix, il
fut promu chef de bataillon. Il était chevalier de la
Légion dĺhonneur depuis la guerre du Mexique. Atteint par la
limite dĺâge, il fut nommé lieutenant-colonel de la
territoriale puis commissaire du gouvernement au conseil de guerre de
Brest, plus tard à Montpellier, où il finit sa
carrière [avril 1892. Ś NDLA.].
Il avait été là
promu officier de la Légion
dĺhonneur.
Voir ses états de service dans les pièces
relatives à la famille Menard.
Il régularisa tardivement à Montpellier
son union libre avec une ouvrière de Sedan, Jeanne
Lamorlette.
Il nĺa laissé quĺun fils, Gabriel, qui,
après avoir échoué à lĺécole de
Saint-Cyr, est entré dans lĺarmée par celle de
Saint-Maixent.
[Il est lieutenant dĺinfanterie au moment où
jĺécris cette note. Il se sent, par ses allures, de la basse
extraction de sa mère. Cependant, il paraît devoir
fournir une carrière honorable. Ś
NDLA.]