Jean Anglade, écrivain clermontois, vient de faire paraître une étude sur les Montgolfier, aux éditions Perrin. Le bouquin, de 400 pages, est extrêmement documenté sur l'ensemble de la famille Montgolfier depuis son origine. Il se lit comme un roman, car Jean Anglade est plein d'humour.
Pour ceux qui hésiteraient à se le procurer, j'ai établi un condensé (et même un hyper-condensé [publié ici par épisodes — NDLR] de ce livre où notre ancêtre Augustin a sa place, bien qu'il ne soit pas l'inventeur de la montgolfière.
Gérald FAUCHER.
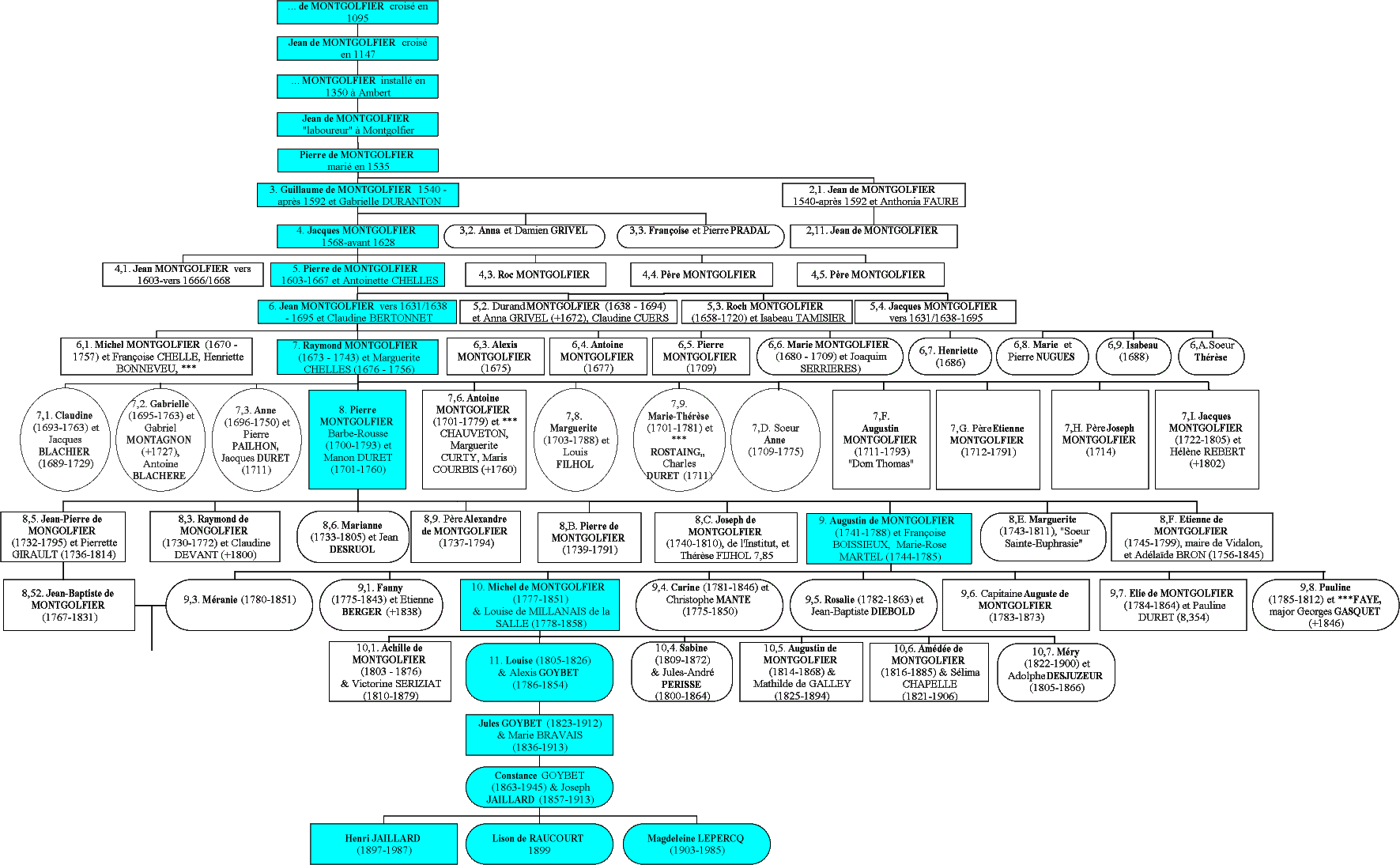
l. Les aïeux

Le premier Montgolfier connu, Jean, se croisa en 1140 et il fut capturé par les Turcs. Il besogna trois ans à Damas dans un moulin à papier, puis réussit à s'enfuir avec deux compagnons. A Sidon, ils rejoignirent d'autres croisés recrus d'aventures, et regagnèrent les rives franques sur un bateau génois ; ils emportaient dans leurs bagages quelques échantillons de la charta damascena, et dans leurs têtes les secrets de sa fabrication.
A La Forie, près d'Ambert, ils achetèrent un vieux moulin à farine, et le convertirent en moulin à papier. Jean Montgolfier fit souche dans ce pays, et sa famille et ses descendants donnèrent leur nom à deux hameaux voisins : Cros-Montgolfier et Montgolfier tout court.
Plusieurs Montgolfier ont adopté la religion réformée ; mais, las des horreurs de la guerre, l'un d'eux décida de quitter l'Auvergne pour des lieux plus tranquilles. Il se réfugia en Beaujolais, se mit sous la protection du sire de Beaujeu, et construisit un moulin au bord du ruisseau de Saint-Didier, sur la route de Chauffailles.
D'autres Montgolfier s'implantèrent dans le voisinage.
En 1693, deux frères de Saint-Didier, Michel et Raymond Montgolfier, quittent le Beaujolais, s'installent à Vidalon, et y font souche.
« L'an 1693, le sixième de janvier, a été passé contrat de mariage de Raymond Montgolfier et de Marguerite Chelles, et le mariage a été consommé le 14 du même mois, pour une légitime génération. » Marguerite donna dix-neuf enfants à Raymond !
Avant de mourir, Raymond fit construire un second moulin en aval du premier et partagea ses biens entre ses deux fils aînés, Pierre et Antoine ; ainsi fut distingué Vidalon-le-Haut, aux mains du premier, et Vidalon-le-Bas, confié au second. Les deux fabriques totalisèrent une centaine de paires de bras.
2. Pierre Montgolfier
(1700-1793),
dit Barbe-Rousse

Il épousa Anne Duret (+ 1760), et ils eurent seize enfants. Deux de ces seize furent Joseph (1740-1810) et Etienne (1745-1799), les inventeurs de la machine volante. Un troisième, Augustin, est notre ancêtre. Ces trois font l'objet d'un chapitre particulier, qui suivra.
Le fils aîné, Raymond, souffrait d'une étrange maladie qui s'en prenait à son corps autant qu'à son esprit, et était incapable de mener à bien les affaires. D'ailleurs, il mourut à quarante ans. Mais Marc Seguin, petit-fils de Raymond, aura été un aussi brillant inventeur que ses oncles : premier concepteur des ponts suspendus et inventeur de la chaudière à vapeur tubulaire. Un autre fils de Barbe-Rousse, Pierre-Félix, souffrait de déraison. Jean-Pierre, lui, était bossu.
En 1783, Pierre Montgolfier reçut du roi ses titres de noblesse :
« ...nous anoblissons ledit seigneur, et du titre de noble et d'écuyer l'avons décoré, et décorons ensemble ses enfants, postérités et descendants mâles et femelles, nés et à naître en légitime mariage. »
En 1785, les fabriques prirent rang de manufactures royales.
En juillet 1790, les passions s'enflammèrent soudainement quand on apprit le vote par l'Assemblée de la constitution civile du clergé, qui séparait l'église française de l'autorité du pape et faisait de nos prêtres des fonctionnaires élus.
De nombreux évêques repoussèrent cette constitution et abandonnèrent leur siège. Ce fut le cas de monseigneur d'Aviau du Bois de Sauzay, évêque de Vienne, qui choisit la clandestinité. Barbe-Rousse l'accueillit et le cacha quelque temps dans sa ferme du Grattet. Après monseigneur d'Aviau, il reçut et cacha plusieurs autres religieux persécutés.
Il ne voulait recevoir les sacrements que d'un prêtre inconstitutionnel. Pour ce faire, le cordelier André Clozel montait chaque dimanche dire la messe dans la petite chapelle, quasi souterraine, de Vidalon.
Le chanoine Alexandre-Charles, fils de Pierre, n'a pu s'empêcher non plus de cacher des prêtres anticonstitutionnels. Au début de 1794, des gendarmes vinrent les arrêter, mais, ne les trouvant pas, ils emmenèrent le vieux réfractaire. Il fut emprisonné d'abord à Beaujeu, puis à Lyon, où il attrapa le mal de la mort. Libéré au début de juillet, il regagna Vidalon, et s'éteignit le 19, entouré de tous les siens.
En 1796, trois ans après la mort de Barbe-Rousse, obligés qu'ils étaient par des ennuis financiers entraînés par les dépenses engagées dans les ballons aérostatiques, les Montgolfier s'associèrent aux Canson de la Lombardière pour le développement de leurs entreprises.
Très rapidement, c'est le gendre d'Etienne, Barthélémy Canson, qui prit les rênes. Le 27 juillet 1803, Barthélémy Canson devint le seul maître des moulins papetiers en versant 80.000 francs aux autres copropriétaires.
3. Joseph de Montgolfier
(1740-1817)
Joseph était destiné à la cléricature et, en conséquence, enfermé au collège de Toumon, chez les Jésuites. Mais très vite, Barbe-Rousse fut convaincu que Joseph n'était fait ni pour le latin, ni pour la théologie.
À 15 ans, Joseph partit pour la capitale. Il se passionna pour les ouvrages de Buffon et pour un fluide nouveau, puissant et invisible, nommé « electricitas », étudié par un Américain d'Amérique : Benjamin Franklin. Il fit la connaissance du naturaliste Daubenton, du mathématicien d'Alembert, de Diderot, l'homme à tout faire de l'Encyclopédie, de l'économiste Bonnot de Mably et de son demi-frère, l'abbé de Condillac, du mécanicien Jacques Vaucanson, constructeur de merveilleux automates...
Joseph épousa, le 17 juillet 1771, sa cousine Thérèse dans la chapelle privée de Vidalon.
Il souffrait d'une permanente étourderie. Un jour, se rendant avec son épouse de Rives à Lyon en berline, il fit étape à Vienne. Marcheur infatiguable, le lendemain matin, il atteignit Lyon vers midi, et s'aperçut alors qu'il avait oublié Thérèse à l'auberge à Vienne.
En 1780, à 40 ans, déjà cinq fois père de famille (deux vivants seulement), il s'inscrivit à la faculté de droit civil et de droit canonique d'Avignon, et, en dix mois, obtint une licence.
En 1772, les deux frères — Joseph et Etienne — avaient construit à Vidalon un ballon aérostatique de papier et de chiffons qui mérite d'être appelé la première montgolfière. « Le globe parcourut une demi-lieue en longueur et mille toises en hauteur perpendiculaire. »
Les expériences et démonstrations continuèrent. Le 4 juin 1783 à Annonay, les deux frères présentèrent une machine qui s'éleva à plus de l.800 toises. De l'Académie des sciences leur vint un engagement à persévérer, signé du marquis de Condorcet. Le 15 septembre 1783 à Versailles, devant le roi, la reine, Monsieur, Madame... et 130.000 personnes, le Réveillon, ayant à son bord un mouton, un canard et un coq, s'éleva à 1.800 toises. Le 15 octobre 1783, premier vol humain, non libre, avec Pilâtre de Rozier. Le 21 octobre 1783, premier vol humain libre, avec Pilâtre de Rozier et le marquis d'Arlandes.
Louis XVI fit frapper une médaille d'or en l'honneur des Montgolfier. Le 21 janvier 1800, Joseph fut nommé administrateur du Conservatoire des arts et métiers, créé six ans plus tôt à l'initiative de l'abbé Grégoire. Le 18 décembre 1803, Joseph reçut la croix de chevalier de la Légion d'honneur.
Le 26 juin 1817, il mourut à Balaruc, où il était allé prendre les eaux avec sa femme. En 1856, sa dépouille fut transférée dans sa ville natale.
Joseph était un inventeur de génie qui ne faisait malheureusement pas protéger ses inventions par un brevet.
Le ballon aérostatique, dont il fut le seul et véritable créateur, aurait, dit la petite histoire, été pensé lorsque Joseph vit qu'une culotte mise à sécher dans la cheminée par son épouse se gonflait et avait tendance à s'élever.
Il eut l'idée du verre de lampe à pétrole, qui devint la lampe à cheminée de verre, qui améliorait l'éclairement, mais surtout évitait l'enfumage. Il vendit cette idée 600 livres au Genevois Argand. Celui-ci, après en avoir déposé le brevet, le faisait fabriquer en Angleterre et le débitait sous le nom de « bec d'Argand ». Puis il en vendit à son tour les droits au pharmacien Quinquet, qui le perfectionna en ajoutant un second courant d'air, les distribua à travers tout le royaume et y gagna beaucoup d'argent.
Après bien des tâtonnements, Joseph mit au point le bélier hydraulique, dont il construisit un prototype expérimental dans sa fabrique de Voiron. Cet appareil, encore utilisé de nos jours, consiste à domestiquer le « coup de bélier » qui se produit dans une conduite d'eau lorsqu'un robinet, brusquement, se referme.
Puis, ensuite, il mit au point la pompe hydraulique. Il proposa au Directoire de remplacer la vieille pompe de Marly qui, depuis un siècle, aspirait l'eau de la Seine et abreuvait Versailles avec un rendement déplorable. Mais le Directoire avait d'autres chats à fouetter.
Le 2 octobre 1796 fut expérimenté avec succès, au-dessus du parc Monceau, par un nommé Gamerin, le premier parachute humain, mis au point par Joseph.
Il pensa le séchage par le vide, au moyen de la pompe de Denis Papin, des moules frais utilisés en imprimerie, et permit ainsi un gain de temps très conséquent.
Il inventa le papier utilisé pour filtrer le café, longtemps dénommé « papier Joseph ».
En 1806, il construisit des métiers à lacets destinés à des enfants recueillis dans une maison de charité.
4. Etienne de Montgolfier
(1745-1799)
Le plus jeune des fils de Barbe-Rousse fut envoyé à Paris pour faire ses études ; au bout de cinq ans, riche d'enseignement et de pratique, il souhaita architecturer. Il entra au service d'un architecte élève de Soufflot et s'occupa, durant quatre ans, de la reconstruction de l'abbaye de Faremoutiers, en Brie.
Mais en 1772, son fils aîné Raymond étant mort, Barbe-Rousse rappela Etienne pour qu'il prenne la suite de son frère. Non sans regrets, Etienne quitta son métier et vint exploiter les moulins dauphinois en commun avec ses frères Joseph, Augustin et Jean-Pierre, le bossu. Et c'est l'aventure des ballons aérostatiques.
Le 8 mars 1774, il épousa Justine Bron, ursuline relevée de ses vœux pro abnuitione (pour motif de non-consentement).
Etienne voyageait beaucoup : il était le commercial de l'affaire familiale. Le 23 juillet 1789, il était à Paris et assista devant l'hôtel de ville à l'arrestation par la foule de l'intendant des finances Foullon de Doué, qu'elle rendait responsable de la famine. Il assista à la pendaison de l'intendant à une de ces lanternes qui éclairaient les rues. Ecœuré par ce spectacle, Etienne rentra chez son oncle et y resta huit jours claquemuré.
Le 2 février 1790, il fut élu maire de Vidalon.
Le 31 juillet 1799, Etienne mourut dans une auberge à deux heures de Vidalon, de retour d'un voyage d'affaires.
5. Augustin de Montgolfier
(1741-1788)
D'un an plus jeune que Joseph, Augustin a mené une vie aventureuse. A 16 ans, 10 livres en poche, il descendit à Paris, trouva logement chez Oncle Jacques et Tante Hélène.
Il gagna son pain comme écrivain public, tenant boutique près des Halles. Sa principale clientèle : des soubrettes amoureuses et des servantes ayant l'habitude de faire danser l'anse du panier.
Il entra ensuite au service d'un bourgeois comme secrétaire ; il y resta trois ans, au bout desquels il reçut un pécule de 600 livres avec quoi il acheta un lot de couteaux, de ciseaux, de rasoirs, de chapelets, de médailles pieuses, et s'en fut vendre cette pacotille aux habitants de l'Inde.
Après quelques temps de commerce, Augustin regagna la France les poches pleines de diamants ; il dépensa tout cela à Bordeaux puis partit pour Saint-Domingue pour refaire fortune. Il n'y réussit qu'à moitié, essaya d'autres îles et y gagna la fièvre quarte et la dysenterie.
Las de tant d'expériences, il décida enfin de revenir aux papiers héréditaires.
Il épousa Françoise Boissieu, jeune fille d'une grande beauté mais d'une santé fragile, qui mourut peu après. En secondes noces, âge de 33 ans, il s'unit à Marie-Rosé Martel, d'une honorable famille lyonnaise.
En 1785, Augustin fut frappé de veuvage pour la seconde fois, avec huit enfants à charge. Il se défit de sa fabrique trop grande de Rives-sur-Fière, et acheta aux Ardillats, près de Beaujeu, une papeterie plus modeste. Courageusement, il commença à l'agrandir et à la rénover. Mais un jour, « inexplicablement, le feu prit au moulin, alors qu'il n'y en avait point dans les cuisines. »
Ayant usé ses forces dans ses travaux de bagnard, Augustin mourut d'un chaud et froid le 29 septembre 1788, laissant huit orphelins âges de 3 à 12 ans.
Gérald FAUCHER.